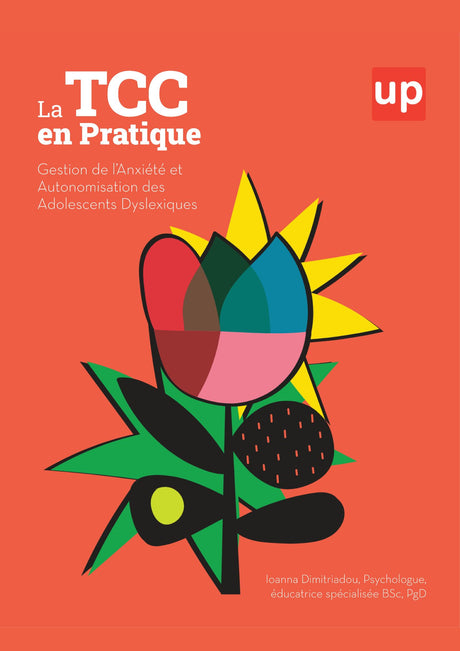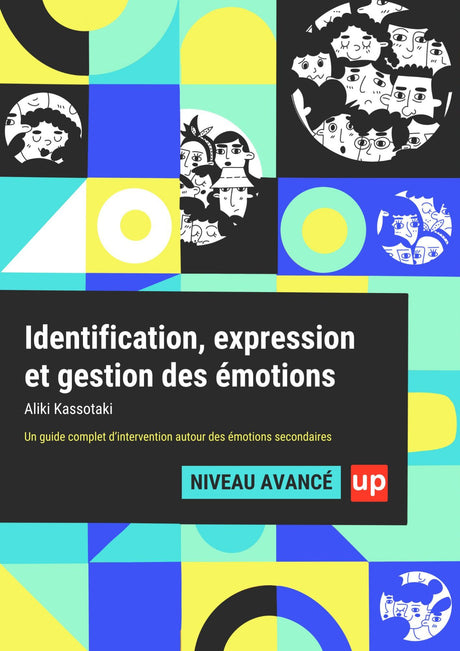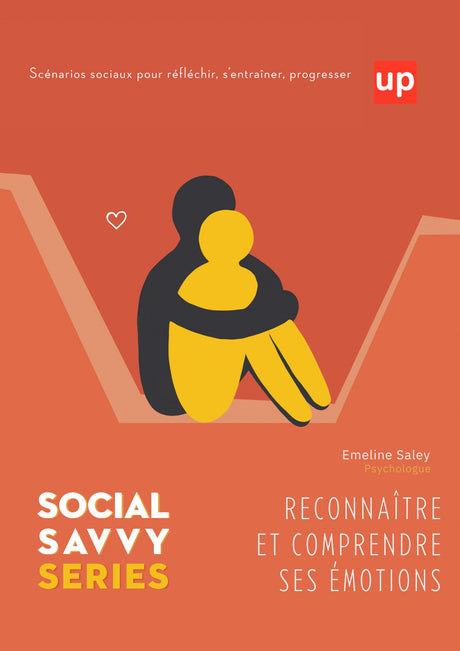L'autisme et la déficience intellectuelle constituent des enjeux complexes et fréquemment sous-estimés pour de nombreuses familles ainsi que pour les professionnels de la santé. Ces conditions, bien que distinctes, partagent des défis similaires en matière de diagnostic, de compréhension et d'intervention. En France, la sensibilisation autour de l'autisme et de la déficience intellectuelle fait l'objet d'une attention croissante, rassemblant chercheurs, thérapeutes et familles afin de mieux appréhender ces réalités.
Points Clés
- L'autisme et la déficience intellectuelle sont souvent associés, mais chaque personne présente un profil unique avec des besoins spécifiques.
- Le diagnostic repose sur une évaluation précise des troubles du spectre autistique et du fonctionnement intellectuel, intégrant les dernières classifications du DSM-5.
- Une prise en charge adaptée, incluant des interventions éducatives et un environnement structuré, est essentielle pour favoriser le développement et l'autonomie des personnes concernées.
Autisme et Déficience Intellectuelle: Définition et Diagnostic

Le Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) est un ensemble de troubles neurodéveloppementaux (TND) qui influencent principalement la communication et les interactions sociales des individus. Les classifications diagnostiques de ce trouble ont considérablement évolué, notamment avec l’introduction du DSM-5. Le DSM-5, publié par l'American Psychiatric Association, regroupe désormais le syndrome d’Asperger (aussi appelé Asperger) sous le spectre de l'autisme. Sous ce manuel diagnostique, des conditions auparavant distinctes comme le syndrome d’Asperger sont désormais regroupées sous une même appellation. Historiquement, un diagnostic d’autisme excluait souvent celui de quelques autres troubles tels que le TDAH. Cependant, cette perspective a changé grâce à une étude récente qui a mis en évidence la cooccurrence de plusieurs troubles. Le TSA est caractérisé par une variabilité importante dans ses manifestations, ce qui signifie que chaque individu peut exprimer des symptômes de manière différente ; par exemple, certains enfants peuvent présenter une forme d’autisme avec un niveau de langage très développé, tandis que d’autres auront des difficultés importantes dans ce domaine. Les révisions du DSM ont été motivées par des recherches approfondies qui ont élargi notre compréhension des troubles associés au TSA, permettant un diagnostic plus nuancé et précis, en intégrant le TSA dans la catégorie des TND. L’utilisation d’outils d’évaluation adaptés est essentielle pour affiner le diagnostic et mieux cerner les besoins spécifiques de chaque personne.
Signes et symptômes de l'autisme
Les signes du Trouble du Spectre Autistique (TSA) incluent typiquement des déficits persistants dans la communication et les interactions sociales. Les comportements, intérêts et activités peuvent également être restreints et répétitifs. Chez les jeunes enfants, ces symptômes peuvent se manifester rapidement, souvent dès l'enfance, parfois dès la naissance, avant même le début de la scolarité, bien que leur impact puisse devenir plus évident à cette étape de la vie. La variabilité des manifestations est une caractéristique clé de l’autisme, l’intensité et la fréquence des symptômes variant d’une personne à l’autre. Cela signifie que deux personnes avec un diagnostic de TSA peuvent présenter des profils très différents. Le TSA, maintenant regroupé sous une appellation unique qui cherche à reconnaître cette diversité, inclut également les troubles associés comme des déficiences dans le langage ou une déficience intellectuelle ; des retards de développement sont souvent constatés.
Les enfants autistes présentent une vulnérabilité accrue face au stress et aux changements dans leur environnement, ce qui peut impacter leur bien-être et leur adaptation au quotidien.
Identification et évaluation de la déficience intellectuelle
La déficience intellectuelle est décelée chez les sujets qui démontrent des limitations significatives dans le fonctionnement intellectuel et le comportement adaptatif, avant l’âge de 18 ans. Le diagnostic repose sur l’évaluation des retards dans les habiletés conceptuelles, sociales et pratiques, à l’aide d’outils spécifiques permettant de mesurer précisément ces retards. Par exemple, un enfant présentant une déficience intellectuelle peut être évalué à l’aide d’un test standardisé pour déterminer son niveau de compréhension verbale et sa capacité à résoudre des problèmes quotidiens.
Un individu est considéré en situation de déficience intellectuelle lorsque son niveau intellectuel global est situé dans les 2 % inférieurs comparé à la population de même âge. Dans certaines études, le nombre de sujets évalués atteint plusieurs centaines, ce qui permet d’obtenir une estimation fiable de la prévalence. La fréquence des cas de déficience intellectuelle détectés lors des bilans de développement varie selon les populations étudiées, mais reste un indicateur important pour le dépistage précoce.
L’évaluation du comportement adaptatif prend en compte l’autonomie de la personne et sa capacité de raison, éléments essentiels pour déterminer le niveau de soutien nécessaire à chaque étape de la vie. Les enfants présentant ces déficiences sont souvent identifiés et évalués plus tôt que leurs pairs. L’origine de la déficience intellectuelle peut être attribuée à des facteurs organiques, incluant des causes génétiques, chromosomiques, périnatales ou postnatales, ainsi que des influences toxiques comme l’alcoolisme fœtal ou l’exposition à des substances toxiques.
Les évolutions des classifications diagnostiques (DSM-III à DSM-5)
L'introduction du DSM-5 a marqué une étape significative dans la classification des troubles du spectre autistique (TSA). Ces troubles sont à présent intégrés dans la catégorie plus large des troubles du neurodéveloppement, ce qui inclut désormais des affections comme l'autisme et le syndrome d'Asperger sous une seule météo clinique. Cette révision élimine les distinctions antérieures entre autisme et autres troubles envahissants du développement (TED), les englobant tous sous TSA. Avant le DSM-5, des combinaisons de diagnostics telles que le TDAH et l'autisme étaient exclues, mais cette approche a évolué, permettant à présent des diagnostics multiples pour un meilleur traitement. Le DSM-5 redéfinit également les concepts précédents, en mettant l'accent sur les déficits persistants de la communication sociale, indépendamment de la présence de comportements restreints et répétitifs. Ces évolutions ont donc transformé l'approche clinique des diagnostics, encourageant une analyse plus holistique des comportements spécifiques associés au TSA.
Causes et facteurs de risque

L’association entre l’autisme et la déficience intellectuelle est complexe et peut intensifier les défis que rencontrent les individus touchés. Cette double condition augmente les risques de complications, notamment en termes de santé, de chutes, d’hospitalisations ou de décès, en raison d’une fragilité accrue. Historiquement, on estimait que jusqu’à 75 % des personnes autistes présentaient une déficience intellectuelle, mais cette proportion est maintenant évaluée à environ 50 %. Cette vulnérabilité accrue expose ces sujets à davantage de comorbidités et de problèmes de santé au fil du vieillissement. Selon une étude récente, le nombre de cas observés dans certaines cohortes atteint plusieurs milliers, ce qui permet de mieux comprendre la prévalence de cette association. La fréquence des cas d’association autisme/DI varie selon les populations étudiées, soulignant l’importance d’une approche individualisée. Cette double condition peut influencer la gravité des symptômes et avoir un impact sur le développement et l’évolution des troubles du spectre autistique. La compréhension des causes et des facteurs de risque de cette association est cruciale pour mettre en place des stratégies d’intervention efficaces. L’élaboration de diagnostics plus précis et de traitements appropriés bénéficie grandement des insights fournis par une analyse approfondie de ces facteurs. Enfin, le rôle des proches et des parents est essentiel dans la gestion des défis quotidiens, en apportant soutien et accompagnement aux personnes concernées.
Implications génétiques et recherches en cours
La recherche génétique a révélé que de nombreux gènes impliqués dans l’autisme se chevauchent avec ceux de la déficience intellectuelle, suggérant une possible origine génétique commune. Cette découverte incite les chercheurs à approfondir l’exploration des mutations génétiques spécifiques à chaque condition. Les bases de données génétiques, comme l’Autism Sequencing Consortium et le UK10K Consortium, s’inscrivent dans le cadre d’un programme international de recherche qui a permis aux chercheurs d’analyser une vaste collection de données génétiques de plus de 35 000 personnes. Ces efforts cherchent à identifier et comprendre les gènes liés à l’autisme, dans le but de mieux expliquer pourquoi les deux conditions coexistent fréquemment. Le séquençage de milliers de génomes entiers contribue à approfondir la compréhension de cette étiologie partagée. L’effet de certaines mutations génétiques sur le développement des troubles du spectre autistique fait l’objet d’une étude approfondie, car il peut influencer la sévérité et la présentation clinique. À travers ces recherches, la communauté scientifique espère affiner les classifications diagnostiques et développer des traitements plus ciblés.
Influence de l'environnement
Adapter l'environnement est une stratégie cruciale pour améliorer la qualité de vie des jeunes ayant un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience intellectuelle. En ajustant leur environnement, comme par l'utilisation d'aides à la communication ou de repères visuels, nous pouvons faciliter leur intégration et participation sociales. Ces adaptations environnementales ne visent pas seulement à une meilleure interaction sociale, mais également à l'autonomisation des individus, leur permettant de développer les compétences nécessaires pour une vie quotidienne plus autonome. En milieu scolaire ou familial, un environnement bien structuré peut aider les jeunes autistes à acquérir des habiletés pratiques. Les services d'accompagnement environnemental sont essentiels, car ils prennent en compte non seulement les besoins individuels des enfants, mais aussi les conditions spécifiques de leur cadre de vie, influençant ainsi positivement le diagnostic et les interventions mises en place.
Enjeux majeurs liés à l'autisme et à la DI
La combinaison de l'autisme et de la déficience intellectuelle (DI) pose des défis significatifs tant pour les individus concernés que pour leurs familles et professionnels de santé. Cette double condition augmente l'intensité des symptômes, rendant l'évolution plus difficile comparée à la présence de l'autisme seul. La prévalence de la déficience intellectuelle associée à l'autisme a évolué au fil du temps. Auparavant estimée à environ 75 %, elle est maintenant d'environ 50 %, marquant une avancée significative dans la reconnaissance et le diagnostic de ces deux conditions. Ce changement met en lumière l'importance cruciale des interventions éducatives, comportementales et développementales, permettant aux personnes concernées de maximiser leur potentiel. De plus, la complexité des symptômes rend difficile l'utilisation des méthodes d'évaluation psychométrique traditionnelles. Les liens génétiques entre l'autisme et la DI ajoutent une couche supplémentaire de complexité, nécessitant des approches spécifiques pour identifier avec précision les facteurs génétiques impliqués.
Défis dans la communication sociale
Les défis dans la communication sociale sont omniprésents chez les personnes présentant des troubles du spectre autistique (TSA). Ces individus font face à des déficits persistants dans la communication et les interactions sociales, similaires à ceux observés chez les personnes ayant un trouble de la communication sociale. Ces difficultés se manifestent souvent par des atypies dans le langage verbal, telles que l'utilisation inappropriée des mots selon le contexte. De même, les atypies non-verbales, comme l'emploi de gestes peu communs, sont caractéristiques de ces troubles. À l'opposé des caractéristiques de l'autisme, les personnes avec un trouble de la communication sociale ne présentent pas les comportements, intérêts ou activités de caractère restreint et répétitif. Cette variété de problèmes de communication peut aller de la difficulté à établir des interactions avec autrui à un retrait social majeur, rendant l'intégration sociale complexe.
Comportements répétitifs et restreints
Les comportements répétitifs et restreints sont des éléments centraux dans le diagnostic du trouble du spectre de l'autisme (TSA), tels que définis par le manuel diagnostique DSM-5. Des comportements moteurs ou langagiers stéréotypés ou répétitifs sont courants, et pourraient inclure une importance exagérée accordée à la similitude ou une adhésion inflexible aux routines. Les comportements restreints englobent également des patrons verbaux ou non-verbaux ritualisés, ou bien des intérêts hautement restreints et anormaux, à la fois en termes d'intensité et de nature. Une autre caractéristique notable est l'hyper-réactivité ou l'hyporéactivité à certains stimuli sensoriels, souvent observée chez ces individus. Cette hypersensibilité ou insensibilité peut engendrer des difficultés supplémentaires pour participer aux activités quotidiennes.
Troubles du sommeil associés
Les troubles du sommeil sont fréquemment observés chez les individus autistes, affectant profondément leur qualité de vie et leur fonctionnement quotidien. Cliniquement reconnus depuis longtemps, ces troubles impactent jusqu'à 60 % des personnes atteintes de TSA. Des études révèlent une corrélation directe entre la sévérité des symptômes autistiques et les troubles du sommeil, soulignant ainsi l'importance d'adresser cette dimension dans les plans de traitement. L'insomnie est particulièrement commune chez les enfants autistes, entraînant des répercussions sur leur développement cognitif et comportemental. Une qualité de sommeil altérée influe non seulement sur le niveau de fonctionnement intellectuel mais également sur le fonctionnement cérébral global, accentuant les difficultés liées à l'autisme et la déficience intellectuelle. Les interventions thérapeutiques visant à améliorer le sommeil devraient être intégrées comme un élément clé des stratégies de prise en charge pour ces individus.
Approches thérapeutiques et interventions

Les approches thérapeutiques pour l'autisme et la déficience intellectuelle visent à améliorer la qualité de vie des personnes touchées en ciblant des domaines spécifiques de développement. Ces interventions incluent des approches éducatives, cognitivo-comportementales et développementales adaptées aux besoins uniques de chaque individu. Le diagnostic précoce et une intervention rapide sont cruciaux, car ils permettent de mettre en place des stratégies personnalisées qui compensent les difficultés des enfants autistes. En conséquence, les séances peuvent cibler l'amélioration des compétences sociales, de communication et des comportements adaptatifs, aidant ainsi les enfants à mieux interagir avec leur environnement. Une évaluation continue par des professionnels est essentielle pour ajuster et personnaliser les interventions en fonction de l'évolution de l'enfant.
Traitements médicaux et comportementaux
Actuellement, il n'existe pas de traitement médicamenteux définitif pour l'autisme, ce qui signifie que le trouble persiste tout au long de la vie. Cependant, les approches éducatives, comportementales et développementales peuvent aider à atténuer certains symptômes. Des essais cliniques récents ont exploré le rôle de molécules pharmacologiques, comme le lithium, dans la restauration du niveau d'expression du gène SHANK3 chez les autistes avec déficience intellectuelle. Ces essais pourraient ouvrir de nouvelles voies pour un traitement potentiel à l'avenir. La Haute Autorité de Santé recommande des interventions éducatives coordonnées, qui aident à structurer l'espace et le temps des personnes autistes, améliorant ainsi leur capacité à interagir socialement et à apprendre de nouvelles compétences. Une intervention comportementale intensive, adaptée régulièrement selon les besoins individuels, peut également optimiser le développement des enfants avec un trouble du spectre de l'autisme.
Importance des recommandations professionnelles
Les recommandations professionnelles sont essentielles pour faciliter un diagnostic précis de l'autisme et de la déficience intellectuelle. Ces recommandations contribuent à l'amélioration des mesures diagnostiques, permettant de distinguer clairement entre les deux conditions. Les personnes qui présentent à la fois une déficience intellectuelle et un trouble du spectre de l'autisme ont besoin de services spécialisés, soulignant l'importance de directives adéquates pour dépister et diagnostiquer correctement ces cas complexes. Des diagnostics précoces et précis permettent un accès rapide à des ressources et des stratégies personnalisées, fondamentales pour le développement et l'épanouissement des enfants concernés. De plus, ces recommandations encouragent la mise en place de pratiques inclusives dans le milieu du travail, promouvant ainsi la diversité et l'équité pour les personnes autistes ou avec déficience intellectuelle.
Concertation avec les associations
La concertation nationale sur le quatrième plan autisme, lancée en juillet 2017, a réuni divers acteurs pour discuter des principales priorités autour de l'autisme. Cette initiative, clôturée par le Président de la République, marque l'importance accordée à ce sujet au niveau étatique. Parmi les cinq axes de travail identifiés lors de ces discussions, l'inclusion scolaire des enfants et jeunes avec autisme a été mise en avant, avec l'objectif de faciliter leur intégration dans le système éducatif classique. Un autre axe s'est concentré sur l'inclusion sociale et l'accès au plein exercice de la citoyenneté pour les adultes avec autisme, incluant l'emploi et le logement. En outre, un soutien accru aux familles touchées par l'autisme a été reconnu comme une priorité, soulignant le besoin de renforcer l'accompagnement et les ressources disponibles pour ces familles.
Sensibilisation et formation
La sensibilisation à l'autisme et à la déficience intellectuelle est vitale pour favoriser une meilleure compréhension et intégration des personnes concernées dans la société. Avec des taux de prévalence pour la déficience intellectuelle associée à l’autisme estimés maintenant à environ 50 %, il est crucial de mettre en œuvre des initiatives éducatives efficaces. Ces efforts visent à améliorer la communication sociale, les compétences adaptatives, et à promouvoir un environnement qui soutient pleinement l’épanouissement des jeunes atteints. L'accent est mis sur l'amélioration des capacités de raisonnement, d'apprentissage et de mémorisation. Cela est essentiel pour autonomiser ces individus et maximiser leur participation sociale. En comprenant mieux les défis et les forces des personnes sur le spectre autistique, la société peut créer des opportunités qui favorisent l’évolution positive et le bien-être de chacun.
Formation des professionnels
La formation des professionnels spécialisés dans l’accompagnement des personnes avec autisme est essentielle pour assurer des interventions de qualité. Dans le cadre du quatrième plan autisme, la concertation nationale intègre un volet majeur dédié à l’amélioration des méthodes d’intervention via la formation continue. Cet effort vise non seulement à sensibiliser davantage les professionnels de la santé, mais aussi à renforcer la qualité des soins et du soutien offerts. En mettant l’accent sur l’innovation et l’adaptation des formations aux besoins spécifiques des personnes autistes, le plan promeut des pratiques basées sur les dernières recherches et approches thérapeutiques. Ainsi, les professionnels sont mieux outillés pour répondre aux défis posés par l’autisme et la déficience intellectuelle, améliorant ainsi le niveau général de fonctionnement et de bien-être des personnes prises en charge.
Soutien aux familles et collectivités territoriales
Le soutien aux familles et aux collectivités territoriales est un pilier central dans la prise en charge des personnes autistes et de celles souffrant de déficience intellectuelle. Autisme Montréal joue un rôle clé en offrant des services d'assistance éducative spécialisée pour renforcer les capacités d'intervention des familles. En collaboration avec les collectivités territoriales et les opérateurs, l’objectif est de structurer et de transformer l’offre d’accompagnement. Cela implique une coordination étroite avec les agences régionales de santé, qui nomment un référent dédié aux troubles du spectre de l’autisme et du neuro-développement pour soutenir l’implémentation des politiques de santé.
Les collectivités territoriales, en partenariat avec les agences de santé, sont directement impliquées dans le développement des services adaptés, ce qui inclut un soutien médico-social pour les adultes handicapés. Ces services facilitent la coordination des soins et l'accompagnement, permettant aux familles de mieux naviguer dans les systèmes disponibles. Grâce à ces efforts concertés, les familles et les collectivités disposent de meilleurs outils pour soutenir efficacement les individus autistes, améliorant ainsi leur qualité de vie et leur intégration sociale.
Recherche

Avancées scientifiques et axes de recherche actuels
La recherche sur le trouble du spectre de l’autisme (TSA) et la déficience intellectuelle connaît un essor remarquable, avec des avancées qui transforment progressivement la compréhension et la prise en charge de ces troubles. Les études récentes s’attachent à décrypter les facteurs génétiques et environnementaux impliqués dans le développement du TSA, tout en explorant les liens complexes entre autisme et déficience intellectuelle. Les chercheurs s’intéressent particulièrement à la neurobiologie du spectre autistique, cherchant à identifier les mécanismes cérébraux sous-jacents aux différentes formes de troubles. Parallèlement, de nouveaux axes de recherche émergent autour de la mise au point de traitements innovants, qu’il s’agisse de thérapies comportementales, éducatives ou de pistes pharmacologiques ciblées. L’amélioration des méthodes de diagnostic et d’évaluation fait également l’objet d’une attention soutenue, afin de détecter plus précocement les caractéristiques du TSA chez les enfants et d’adapter la prise en charge à chaque profil. Enfin, la prévalence et la diversité des manifestations du trouble du spectre de l’autisme sont étudiées à travers de larges cohortes, permettant de mieux cerner les besoins spécifiques des personnes concernées et d’orienter les politiques de santé publique.
Impact de la recherche sur les pratiques cliniques
Les progrès réalisés dans la recherche sur le TSA et la déficience intellectuelle ont un impact direct et tangible sur les pratiques cliniques. Grâce à une meilleure compréhension des bases neurobiologiques et génétiques de ces troubles, les professionnels de santé peuvent désormais proposer des stratégies de prise en charge plus personnalisées et efficaces. Les études portant sur les troubles associés, comme l’anxiété ou la dépression, permettent d’anticiper et de répondre de manière ciblée aux besoins spécifiques des personnes autistes, optimisant ainsi leur accompagnement. Par ailleurs, l’évolution des outils de diagnostic, fruit de recherches approfondies, contribue à une identification plus rapide et plus précise des cas, ouvrant l’accès à des services adaptés dès les premiers signes. Cette dynamique de recherche favorise également l’émergence de nouvelles approches thérapeutiques, qui tiennent compte de la diversité des profils et de l’intensité des déficiences, tout en allégeant la charge pesant sur les familles et les professionnels. En somme, l’intégration des résultats scientifiques dans la pratique quotidienne améliore la qualité de vie des personnes concernées et renforce l’efficacité des dispositifs de prise en charge.
Politiques publiques
Cadre législatif et réglementaire
La mise en place de politiques publiques adaptées est un levier essentiel pour garantir l’inclusion et le respect des droits des personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) ou une déficience intellectuelle. En France, la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a constitué une avancée majeure, en posant les bases d’un accès renforcé à l’éducation, à l’emploi et aux services de santé pour les personnes autistes. Ce cadre législatif impose la prise en compte des besoins spécifiques liés à la déficience intellectuelle et au TSA, et encourage la mise en place de services adaptés sur l’ensemble du territoire. Les politiques publiques visent également à sensibiliser la société aux réalités du spectre autistique, à lutter contre les discriminations et à promouvoir la pleine participation des personnes concernées à la vie sociale. À l’échelle internationale, des organisations telles que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et les Nations Unies œuvrent pour l’harmonisation des droits et la reconnaissance des besoins des personnes autistes, incitant chaque pays à renforcer ses dispositifs de soutien. L’exemple français illustre ainsi la volonté de placer la personne au centre des politiques, en adaptant les services et en favorisant l’autonomie et l’inclusion, tout en tenant compte de la diversité des situations et des parcours.
Conclusion
L'autisme et la déficience intellectuelle, bien que distincts, sont souvent étroitement liés et représentent des défis majeurs tant pour les personnes concernées que pour leur entourage et les professionnels. La compréhension approfondie de cette association, grâce aux avancées diagnostiques et à la recherche, permet aujourd'hui de mieux adapter les interventions pour répondre aux besoins spécifiques de chaque individu. La mise en place de politiques publiques inclusives, le soutien aux familles, ainsi que la formation des professionnels sont essentiels pour favoriser l'autonomie, l'intégration sociale et le bien-être des personnes vivant avec ces conditions. Continuer à sensibiliser la société et à investir dans la recherche reste fondamental pour améliorer la qualité de vie et l'avenir des personnes autistes avec déficience intellectuelle.
Questions fréquemment posées
L'autisme et la déficience intellectuelle sont-ils toujours associés ?
Non, bien que l'autisme et la déficience intellectuelle soient souvent associés, chaque personne présente un profil unique. Environ 50 % des personnes autistes ont une déficience intellectuelle, mais d'autres n'en présentent pas.
Comment se fait le diagnostic de ces troubles ?
Le diagnostic repose sur une évaluation clinique approfondie, intégrant les critères du DSM-5, ainsi que des tests standardisés pour mesurer le fonctionnement intellectuel et adaptatif. Il est important d'utiliser des outils adaptés pour cerner les besoins spécifiques de chaque individu.
Quels sont les principaux défis pour les personnes concernées ?
Les personnes avec autisme et déficience intellectuelle peuvent rencontrer des difficultés dans la communication sociale, des comportements répétitifs, des troubles sensoriels, ainsi que des troubles du sommeil. Ces défis varient en intensité selon les individus.
Existe-t-il un traitement pour l'autisme et la déficience intellectuelle ?
Il n'existe pas de traitement curatif pour l'autisme ou la déficience intellectuelle. Cependant, des interventions éducatives, comportementales et développementales adaptées peuvent améliorer la qualité de vie, favoriser le développement des compétences et l'autonomie.
Quel est le rôle des familles et des proches ?
Les familles jouent un rôle essentiel en apportant soutien, accompagnement et en participant à la mise en place des interventions. Leur implication est cruciale pour le bien-être et le développement des personnes concernées.
Comment la société peut-elle mieux soutenir ces personnes ?
La sensibilisation, la formation des professionnels, la mise en place de politiques publiques inclusives et un environnement adapté sont des leviers importants pour faciliter l'inclusion sociale, scolaire et professionnelle des personnes avec autisme et déficience intellectuelle.
Contenu original de l'équipe de rédaction d'Upbility. La reproduction de cet article, en tout ou en partie, sans mention de l'éditeur est interdite.
Références
-
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.
-
Baio J, Wiggins L, Christensen DL, et al. (2018). Prevalence of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 8 Years – Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 Sites, United States, 2014. MMWR Surveill Summ, 67(6), 1-23.
-
Baghdadli A., Miot S., et al. (2018). Vieillissement et trouble du spectre autistique. NPG Neurology Psychiatry Geriatry, 18, 78-85.
-
Bowen, A. (2014). Eligibility for autism services: The role of IQ and adaptive functioning. Autism Research, 7(4), 463-470.
-
Compagnon C. (2020). Mieux connaître la prévalence des troubles du spectre de l'autisme (TSA), mais aussi les conditions de vie des personnes présentant un TSA, un défi pour notre politique publique. Bulletin épidémiologique hebdomadaire, 6-7.