Définition et caractéristiques du discours narratif
Le discours narratif est un type de discours qui consiste à raconter une histoire, un événement ou une série d’événements. Il se distingue par la présence d’un narrateur qui relate les faits en utilisant des verbes d’action, des indicateurs temporels et spatiaux, ainsi que des descriptions détaillées de personnages et de lieux. Ce type de discours peut prendre diverses formes, telles que le roman, la nouvelle, le récit de guerre, et bien d’autres. Le narrateur joue un rôle central en guidant le lecteur à travers l’histoire, en créant une immersion dans le récit. Les caractéristiques du discours narratif incluent une structure temporelle claire, des transitions logiques entre les événements, et une attention particulière aux détails qui enrichissent l’histoire.
Le discours narratif
Le discours narratif est un genre littéraire qui raconte une histoire se déroulant dans un lieu et à une époque donnés. Il est raconté par un narrateur qui peut être un narrateur-personnage, impliqué directement dans l’histoire, ou un narrateur externe, qui observe et relate les événements sans y participer. Le temps de base pour rédiger un texte narratif varie : le présent de l’indicatif est utilisé lorsque l’énoncé est ancré dans la situation d’énonciation, tandis que le passé simple est préféré lorsque l’énoncé est coupé de la situation d’énonciation. Cette distinction temporelle permet de situer clairement les événements dans le temps et de structurer le récit de manière cohérente.

Le point de vue dans la narration
Le point de vue dans la narration est la perspective à partir de laquelle le narrateur relate les événements. Il peut être interne, externe ou omniscient. Le point de vue interne est celui où le narrateur est un personnage de l’histoire et relate les événements à partir de sa propre perspective, offrant ainsi une vision subjective et intime des événements. Le point de vue externe, en revanche, est celui où le narrateur est en dehors de l’histoire et relate les événements de manière objective, sans être impliqué personnellement. Enfin, le point de vue omniscient est celui où le narrateur connaît tout sur les personnages et les événements, et peut ainsi offrir une vision complète et détaillée de l’histoire. Chaque point de vue apporte une dimension unique au récit et influence la manière dont les événements sont perçus par le lecteur.
Les formes narratives
Les formes narratives sont les différentes manières dont le discours narratif peut être présenté. Il peut prendre la forme d’un roman, d’une nouvelle, d’un récit de guerre, ou encore d’un conte, entre autres. Chaque forme narrative possède ses propres caractéristiques et conventions, adaptées au ton, au style et au public visé. Par exemple, un roman permet une exploration approfondie des personnages et des intrigues complexes, tandis qu’une nouvelle se concentre souvent sur un événement unique ou une situation particulière. Les récits de guerre, quant à eux, mettent en avant des événements historiques et des expériences personnelles liées aux conflits. En variant les formes narratives, les auteurs peuvent expérimenter avec différentes techniques de narration et captiver leur audience de manière diverse et innovante.
Le discours narratif est la narration, écrite ou orale, d'un événement ou d'une suite d'événements, réels ou imaginaires.
La narration s'organise en fonction du contexte spatio-temporel, mais aussi en suivant une logique de cause à effet.
Organisation. Il s'agit de la manière dont se structure le discours narratif. Ce dernier est organisé autour des trois axes suivants :
- Début : présentation des personnages et du contexte spatio-temporel,
- Milieu : épisode(s) (élément déclencheur/action initiale, péripéties, dénouement/solution),
- Fin : situation finale (résultat, jugement du narrateur sur l'histoire qu'il a racontée).
Cohérence. La cohérence d'un texte narratif est assurée par la bonne organisation de la narration, mais aussi par l'utilisation de connecteurs logiques adéquats. Plus précisément, elle est rendue possible par :
-
Des connecteurs comme des prépositions, des adverbes et des expressions qui indiquent le temps, la cause, la conséquence, l'opposition, l'ajout, l'explication, l'exemple, l'hypothèse, la confirmation, la conclusion, etc.
-
La répétition d'expressions ou de mots, pour mettre de l'emphase sur ce que l'on dit.
-
L'utilisation de pronoms pour enrichir le récit en évitant les répétitions.
Caractéristiques linguistiques du discours narratif. Les phrases sont liées entre elles par des mots (“d'abord”, “ensuite”, “après”, “enfin”, etc.) ou des expressions qui indiquent la succession temporelle, mais elles comprennent également des termes qui précisent la relation causale (par exemple : “parce que”, “puisque”, “comme”, “à cause de”, etc.).
Les verbes de la narration indiquent généralement l'action (par exemple : “courir”, “tomber”, “aller”, “rencontrer”, etc.), ou la réflexion et l'émotion (“penser”, “croire” , “songer”, “se sentir”, “éprouver”, “se réjouir”, “se désoler”, “craindre”, etc.).
Ces verbes sont généralement conjugués au passé : imparfait et passé composé (ou passé simple). Le temps de la narration est, par excellence, le passé composé (ou le passé simple, dans certains récits écrits).
1. Stade des éléments juxtaposés - 2 ans
Il s'agit du stade au cours duquel l'enfant juxtapose une série d'objets et d'idées qui se basent sur les perceptions immédiates, sans organisation (macrostructure) et avec très peu de liens d'une phrase à l'autre, voire pas du tout. Les histoires produites sont des accumulations de phrases. Ce stade représente le début du développement du discours (McCabe & Rollins, 1994). L'enfant peut exprimer une série d'idées sans rapport les unes avec les autres, contrairement à l'adulte, qui établit entre les faits des relations causales ou chronologiques. L'adulte applique une macrostructure ; il suit le schéma narratif.
Les enfants de deux ans relatent principalement des actions et ont recours à des verbes d'action.
2. Stade de la séquence - de 2 à 3 ans
Ce stade est caractérisé par la présence de macrostructures simples, focalisées sur un personnage central ou un élément du contexte, mais pas sur l'intrigue. Malgré leur appellation de “séquences”, les histoires de ce type comprennent des événements qui ne sont pas forcément liés les uns aux autres, chronologiquement ou selon une relation causale.
La séquence est brève et elle se compose, en général, d'événements connus. L'histoire comprend un personnage principal, le sujet ou le contexte. Les phrases utilisées ont une structure simple et présentent des actions précises (verbes), pour donner une information brève mais claire. Les causes et les motivations sont généralement absentes.
3. Stade de la prénarration - de 3 à 4 ans
À ce stade, le récit comprend un noyau : un personnage principal, un objet ou un événement. Au contraire de ceux de la séquence, les éléments de la prénarration sont en accord logique avec les caractéristiques de ce noyau, c'est-à-dire du thème. Ainsi, un méchant fait le mal et est puni, tandis qu'un gentil fait le bien et, généralement, en est récompensé. C'est le stade où une conclusion commence à faire son apparition dans les histoires : une action conduit à une émotion ou un ressenti, qui aboutit à un événement. Le but est qu'une histoire soit maintenue, mais pas encore que les problèmes soient résolus (Garnett, 1986).
La prénarration, comme la séquence, comprend un personnage principal, un sujet ou un contexte. L'histoire s'organise autour du thème central, par l'ajout d'informations ou d'événemements. Ces derniers commencent à apparaître entre l'âge de trois et cinq ans (Owens, 2010). Ce qui différencie ce stade de celui des séquences est ce que dit l'enfant du personnage, les expressions de son visage ou sa posture. En outre, les pronoms font leur apparition dans le récit.
4. Stade de la chaîne non thématique - de 4 à 4 ans et demi
À ce stade, il n'y a pas de personnage principal ou de sujet principal, et donc pas de macrostructure, mais les éléments isolés sont reliés entre eux : chacun a un lien avec le suivant. Pour raconter une histoire, l'enfant doit être en mesure de former une chaîne d'actions, en expliquant ce qu'il se passe et pour quelle raison cela se passe (Kemper & Edwards, 1986). Les chaînes non thématiques ne comprennent pas de personnage principal ; elles consistent en une suite d'actions liées chronologiquement ou causalement. Les éléments autour desquels une histoire est normalement centrée, comme le personnage, le contexte ou l'action, changent ; dès lors, l'histoire ne possède pas de thème central.
Les connecteurs “et”, “mais” et “parce que” font leur apparition dans ces histoires ; les enfants deviennent capables de narrer un épisode complet. Ils commencent à parler d'expériences communes, à pouvoir commenter des états mentaux - les leurs comme ceux d'autrui - et à comprendre les liens de cause à effet, en utilisant divers connecteurs logiques. Leur action est limitée lorsqu'il leur est demandé d'imaginer une histoire, étant donné qu'ils ne sont pas habitués aux motivations complexes.
5. Stade de la chaîne thématique - 5 ans
Il s'agit de la combinaison d'un personnage ou d'un thème central avec une réelle succession des événements. Cependant, les événements ne dépendent pas des caractéristiques du personnage et les personnages n'ont pas de motivations pour atteindre un but. En outre, les histoires de ce type ont souvent une “fin” brusque.
Le développement d'épisodes complets sous la forme de récits bien construits a lieu vers l'âge de cinq ans. À cet âge, l'enfant peut raconter des histoires amusantes, avec des épisodes, un contexte et des résultats.
Les chaînes thématiques comprennent un personnage principal et une succession logique des faits. Les histoires sont construites autour d'un personnage, qui traverse une série de situations bien précises liées les unes aux autres (Owens, 2010). Les faits décrits ont souvent la forme d'une “aventure” et l'auditeur est appelé à interpréter la fin.
6. Stade narratif - 6 ans
Les récits aboutis ont un thème central, un personnage principal et une intrigue. À ce stade, les histoires comprennent cinq parties : un fait initial, une motivation, une tentative ou une action, une conséquence et une résolution du problème. Elles comportent des éléments qui expliquent les motivations des personnages ; de plus, les événements suivent une logique temporelle ou causale. Les enfants en âge préscolaire montrent une connaissance de la structure d'une histoire, quand le contexte est suffisamment clair. En grandissant, ils commencent à relier les événements ; les narrations deviennent plus longues, avec des structures syntaxiques complexes, tandis qu'émergent une série de connecteurs. Toutefois, cela ne se produit que quand ils sont entrés à l'école à l'âge de six ans. Ils apprennent alors à raconter des histoires sur la “vie intérieure” des personnages, comme le montrent des réponses personnelles (Kemper, 1984, Roth & Spekman, 1987, Westby, 1991). Les récits aboutis sont organisés ; leur structure suit le modèle des histoires.




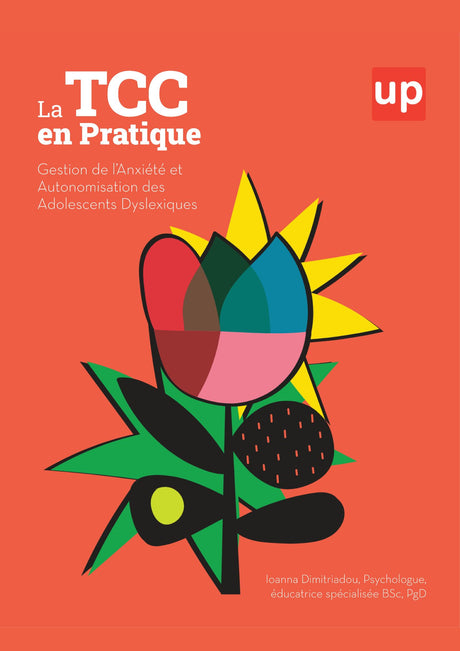
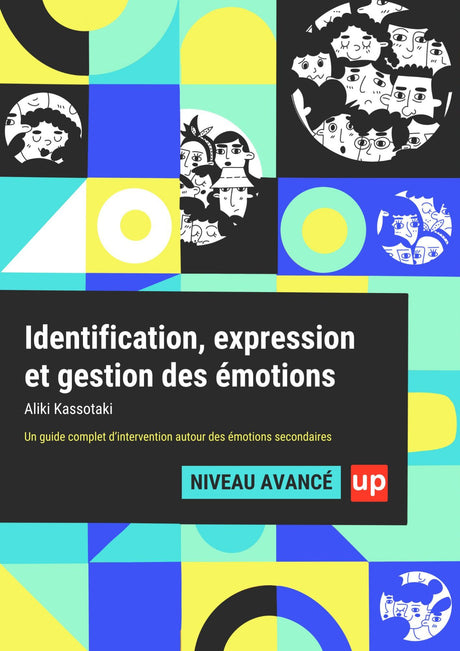
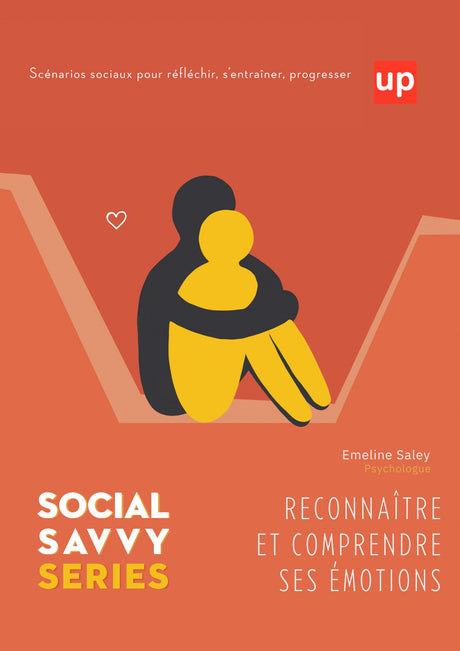


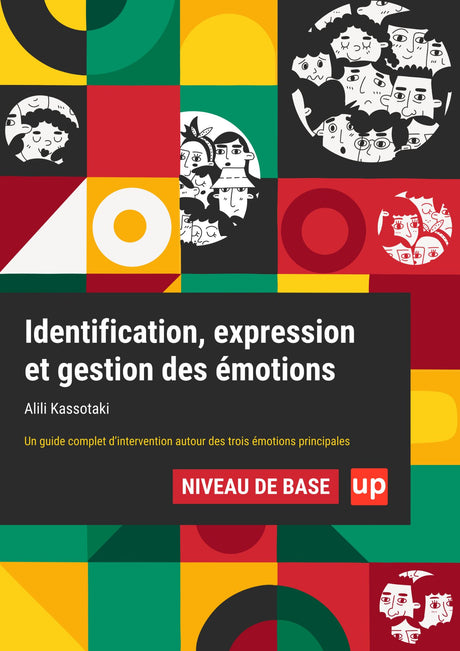
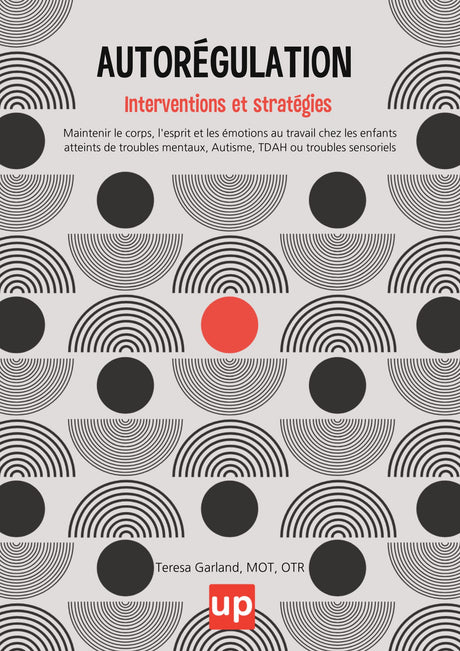
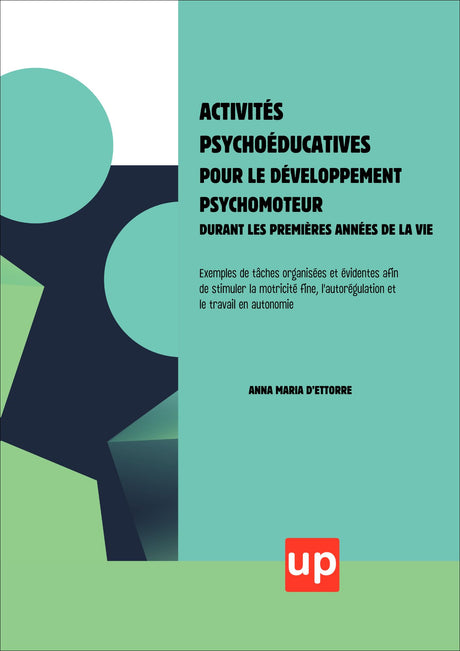
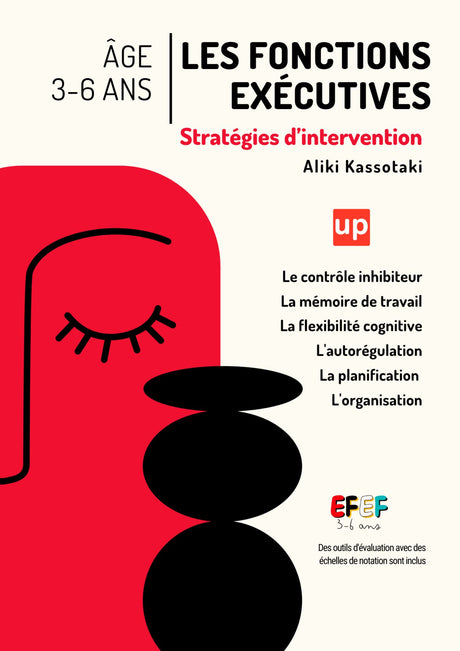
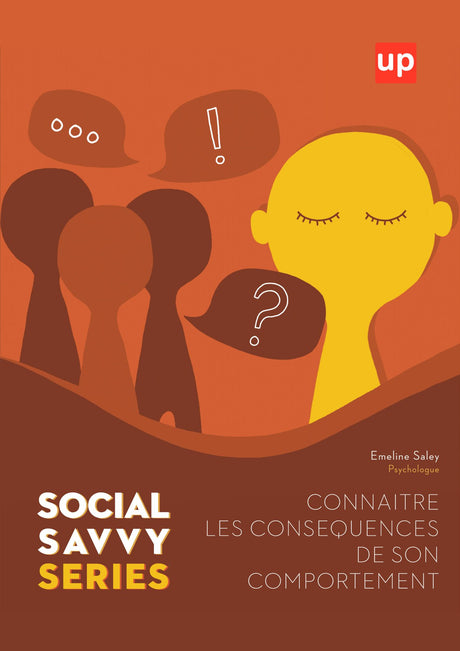
1 commentaire
Que peut on proposer à un enfant de 11ans TSA qui a un grand problème de compréhension de texte ce qui représente sa plus grande difficulté au collège.