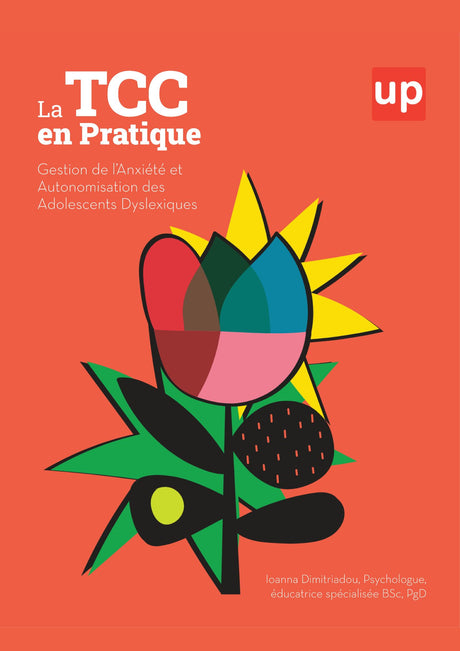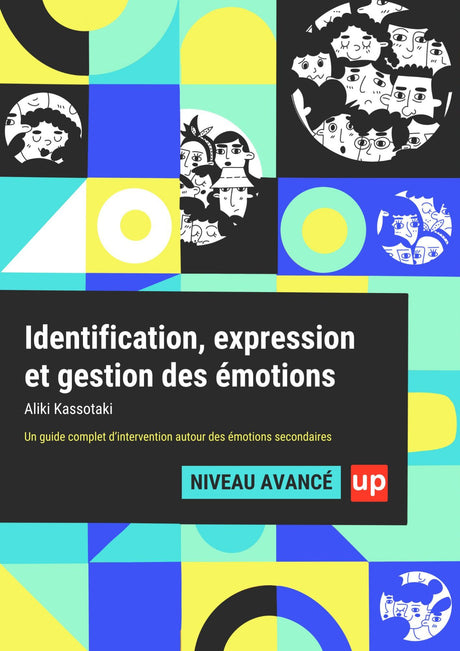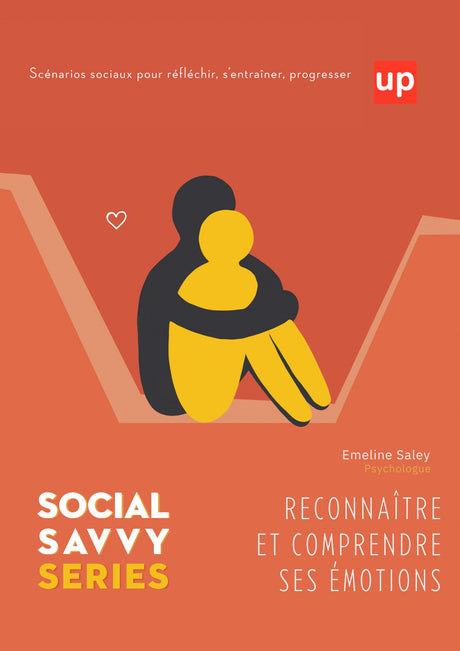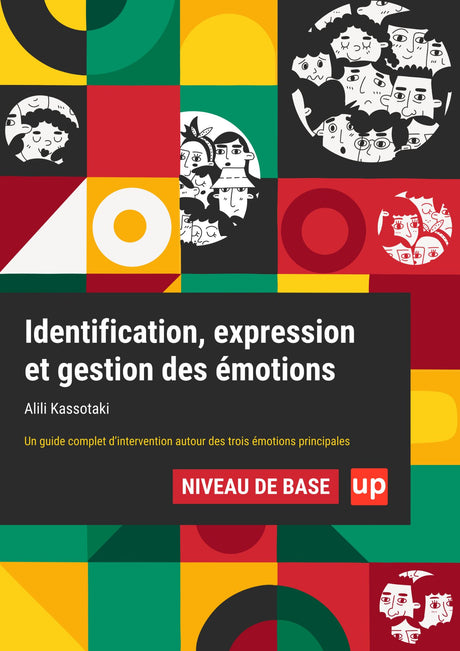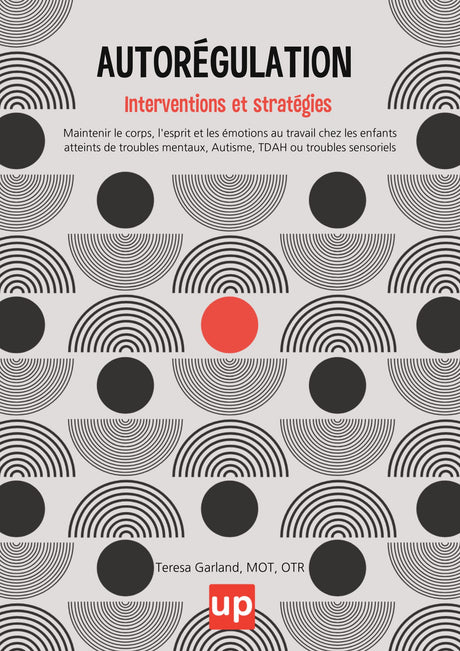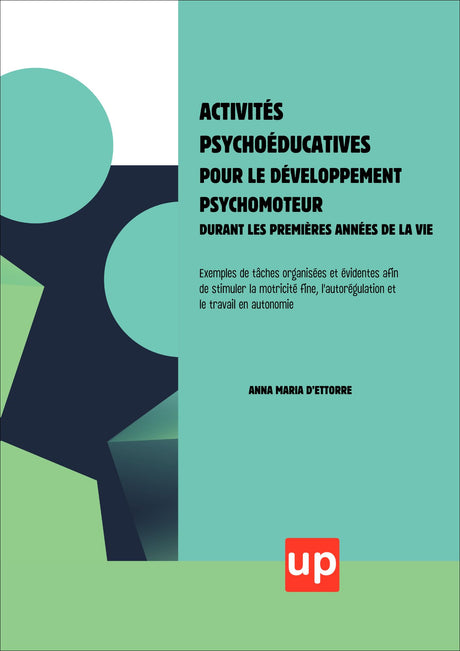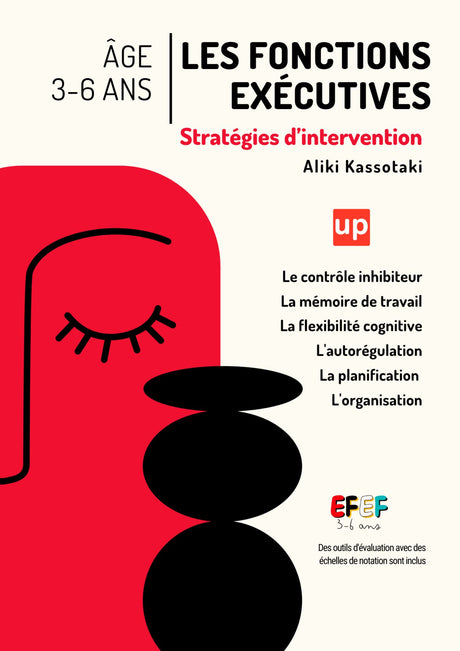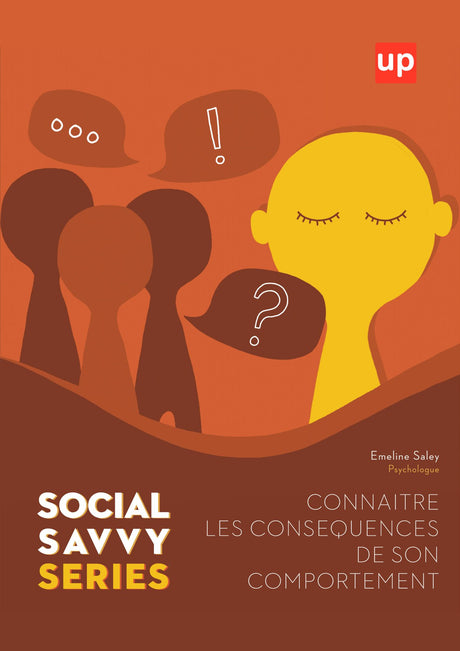Le désir de s'améliorer est une aspiration profondément humaine. Qu'il s'agisse d'adopter une routine d'activité physique, de modifier son alimentation ou d'améliorer ses habitudes de travail, l'intention est souvent la première étincelle. Pourtant, transformer cette intention en un changement de comportement durable est un défi bien plus complexe qu'il n'y paraît. Ce n'est pas une simple question de volonté, mais un processus complexe influencé par notre psychologie, notre environnement et même notre biologie. Cet article explore les stratégies fondées sur les sciences du comportement pour naviguer ce parcours, depuis la compréhension des mécanismes sous-jacents jusqu'à l'élaboration d'un plan d'action robuste et personnalisé. Nous verrons comment les modèles théoriques éclairent la pratique et comment des facteurs, parfois insoupçonnés comme des conditions médicales, peuvent redéfinir entièrement l'approche du changement.
Points clés
- Le changement de comportement repose sur l’interaction entre la capacité, l’opportunité et la motivation, comme le souligne le modèle COM-B.
- Un accompagnement personnalisé et une communication adaptée sont essentiels pour surmonter les freins et soutenir la durabilité des nouvelles habitudes.
- La santé mentale et les conditions médicales influencent fortement la réussite du changement, nécessitant une approche intégrative et bienveillante.
Comprendre les fondements essentiels du changement de comportement

Pour initier une transformation durable, il est impératif de comprendre les mécanismes qui régissent nos actions. La psychologie du comportement est une matière centrale pour appréhender les changements, et la psychologie de la santé nous offre plusieurs cadres d’analyse puissants. L’apport des sciences du comportement permet de mieux saisir les processus de changement dans le domaine de la santé publique et de la psychologie. Ces modèles de changement de comportement visent à expliquer le comportement humain et ne sont pas de simples théories académiques ; ce sont des cartes pour naviguer la complexité de la nature humaine. Certains termes clés structurent la compréhension du changement de comportement et facilitent l’élaboration d’interventions adaptées.
L’un des plus connus est le Modèle Transthéorique (ou Étapes du Changement) de Prochaska et DiClemente, qui décompose le processus en phases distinctes : pré-contemplation, contemplation, préparation, action, et maintien. Ce modèle souligne que le changement est rarement linéaire et que la rechute est une étape d’apprentissage normale, non un échec. L’explication claire de ces étapes est essentielle pour faciliter leur application dans le domaine de la prévention santé.
Plus récemment, le modèle COM-B a gagné en popularité pour sa simplicité et son efficacité. L’idée centrale de ce modèle est d’articuler capacité, opportunité et motivation pour comprendre la façon dont un comportement humain peut évoluer. Il postule que pour qu’un Comportement (B) se produise, trois conditions doivent être réunies : la Capacité (C) physique et psychologique de le faire, l’Opportunité (O) environnementale et sociale de l’exécuter, et la Motivation (M) de l’adopter. Si l’un de ces trois piliers est faible, le changement est compromis. Par exemple, vouloir faire de l’exercice (Motivation) ne suffit pas si l’on manque de connaissances sur les bons mouvements (Capacité psychologique) ou si la salle de sport la plus proche est trop loin (Opportunité environnementale).
Ce modèle est complété par la Roue du changement de comportement (Behaviour Change Wheel), un outil qui identifie neuf types d’interventions possibles (comme l’éducation, la persuasion, l’incitation ou la restriction) en fonction du pilier du COM-B à renforcer. Au-delà de ces cadres structurés, il est crucial de reconnaître le rôle des modèles mentaux : nos croyances profondes et souvent inconscientes sur nous-mêmes et le monde. Une croyance limitante comme “je ne suis pas sportif” peut saboter les meilleures intentions avant même que l’action ne commence.
Explorer les modes de vie et leur impact sur nos habitudes
Les modes de vie façonnent en profondeur nos comportements quotidiens et influencent directement notre bien-être et notre santé. Comprendre comment nos pratiques, qu’il s’agisse de l’alimentation, de la consommation d’alcool, de l’activité physique ou de la qualité de nos relations sociales, interagissent avec notre environnement est fondamental pour initier des changements durables. Les professionnels de la santé publique s’accordent sur la nécessité d’adopter une approche globale, prenant en compte l’ensemble des facteurs qui déterminent nos habitudes de vie.
Les interventions efficaces ne se limitent pas à cibler un comportement isolé, mais s’attachent à modifier l’ensemble du mode de vie de l’individu. Par exemple, encourager une meilleure alimentation sans tenir compte du contexte social ou des habitudes de consommation risque d’avoir un impact limité. De même, la prévention des maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète ou certains cancers passe par une compréhension fine des liens entre nos choix quotidiens et l’apparition de ces problèmes de santé.
Les professionnels doivent donc identifier les facteurs de risque et les leviers d’action propres à chaque individu, afin de proposer des interventions personnalisées et adaptées à la réalité de leur vie. Cette démarche globale permet non seulement de prévenir l’apparition de maladies, mais aussi d’améliorer la qualité de vie et le bien-être général des personnes accompagnées.
Architectures stratégiques pour un parcours de transformation durable

Comprendre la théorie est une chose, l’appliquer en est une autre. Les techniques de changement de comportement visent à traduire ces modèles en actions concrètes. Un accompagnement personnalisé est essentiel pour soutenir l’individu tout au long de son parcours de changement. La clé est de construire une architecture de soutien autour de l’individu, en agissant sur les trois leviers du modèle COM-B.
Renforcer la Capacité : La capacité n’est pas innée ; elle se construit.
- Capacité psychologique : Cela implique d’acquérir les connaissances nécessaires. Si l’objectif est de mieux manger, il faut apprendre les bases de la nutrition. Cela inclut aussi de développer des compétences cognitives comme la planification des repas ou la gestion des fringales.
- Capacité physique : Il s’agit de s’assurer que le corps est apte à réaliser le comportement souhaité. Pour une personne sédentaire, commencer une activité physique intense sans préparation peut mener à des blessures, anéantissant la motivation. Une approche progressive est essentielle. Le professionnel de santé joue ici un rôle clé dans l’accompagnement et la mise en œuvre des stratégies adaptées.
Optimiser l’Opportunité : Notre environnement exerce une influence considérable sur nos actions.
- Opportunité physique : Modifier son environnement pour rendre le comportement souhaité plus facile et le comportement indésirable plus difficile. Par exemple, préparer ses vêtements de sport la veille au soir ou ne pas acheter de malbouffe pour ne pas être tenté. Différentes activités peuvent être proposées pour soutenir le changement de comportement, telles que des ateliers pratiques, des séances d’information, des groupes de soutien ou des défis collectifs.
- Opportunité sociale : S’entourer de personnes qui soutiennent le changement. Rejoindre un groupe de course ou annoncer ses objectifs à ses proches peut créer un sentiment de responsabilité et de soutien. Différents acteurs interviennent dans ce processus : professionnels, pairs, proches ou membres d’associations, chacun apportant un soutien spécifique.
Cultiver la Motivation : La motivation est le moteur du changement, mais elle est fluctuante.
- Motivation réflexive : Elle est liée à nos objectifs et à nos valeurs. Il est utile de se rappeler régulièrement pourquoi on a initié ce changement. Cela peut passer par la visualisation des bénéfices à long terme ou la définition d’une identité (“Je suis une personne qui prend soin de sa santé”).
- Motivation automatique : Elle est liée aux émotions et aux habitudes. Associer le nouveau comportement à une récompense immédiate (écouter un podcast apprécié uniquement pendant sa séance de sport) peut aider à créer une boucle de renforcement positif.
La réussite du changement repose souvent sur des projets structurés et planifiés, intégrant l’accompagnement des professionnels et l’implication des différents acteurs pour maximiser l’efficacité des interventions.
L’importance de la santé mentale dans le processus de changement

La santé mentale occupe une place centrale dans tout processus de changement de comportement. Les attitudes, la motivation et les habitudes sont profondément influencées par l’état psychologique de l’individu. Lorsqu’une personne souffre de troubles tels que la dépression ou l’anxiété, il devient souvent plus difficile d’adopter de nouveaux comportements bénéfiques pour la santé. Les obstacles ne sont alors pas seulement d’ordre pratique, mais relèvent aussi de la capacité à mobiliser l’énergie et la volonté nécessaires pour initier et maintenir le changement.
Les professionnels de la santé doivent donc intégrer l’évaluation de la santé mentale dans leurs interventions, en adaptant leurs stratégies aux besoins spécifiques de chaque individu. Il ne s’agit pas seulement de proposer des conseils ou des plans d’action, mais aussi de soutenir la personne dans la gestion de ses émotions, de ses croyances et de ses freins psychologiques. La recherche en santé publique montre que les interventions qui prennent en compte la santé mentale sont plus efficaces pour favoriser l’adoption de comportements sains et améliorer la qualité de vie.
En reconnaissant l’importance de la santé mentale, on peut mieux accompagner les individus dans leur parcours de changement, en leur offrant des ressources adaptées et un soutien continu tout au long du processus.
Élaboration d'un plan d'action rigoureux et adapté
Une fois les stratégies définies, il faut les structurer dans un plan d’action clair et personnalisé. Un objectif vague comme “être en meilleure santé” est une recette pour l’échec. Un plan efficace suit des principes éprouvés.
Le Protocole en 5 étapes, souvent utilisé dans des contextes de transition écologique mais applicable à tout changement, offre une feuille de route claire :
- Diagnostiquer : L’identification précise du comportement à changer est essentielle, tout comme l’analyse des freins et leviers grâce au modèle COM-B. Il s’agit également d’examiner les déterminants psychologiques, sociaux ou environnementaux qui influencent ce comportement. L’analyse du problème de départ conditionne la réussite du plan, et la formulation de la question centrale à résoudre permet de cibler efficacement l’intervention. Adapter le plan d’action aux besoins du public cible est aussi crucial pour maximiser l’impact.
- Cibler : Choisir une ou deux interventions prioritaires. Il est contre-productif de tout vouloir changer en même temps.
- Concevoir : Définir des actions concrètes. Utiliser la méthode SMART (Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporellement défini). Par exemple, “marcher 30 minutes, 3 fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis avant le travail”. Le plan d’action doit aider à prendre de meilleures décisions pour la santé.
- Déployer : Mettre le plan en œuvre, en commençant par de petites étapes pour construire un sentiment de compétence et de succès. La progression est plus importante que la perfection.
- Évaluer : Suivre les progrès, ajuster le plan si nécessaire et célébrer les réussites, même modestes.
La résistance au changement est une réalité. Des études montrent qu’environ 70 % des changements organisationnels n’atteignent pas leurs objectifs en raison de la résistance humaine, un principe qui s’applique aussi à l’échelle individuelle. Accepter que des obstacles surgiront et préparer des stratégies pour y faire face (ex: “Si je rate une séance, je ne culpabilise pas et je reprends le lendemain”) est un élément crucial du plan.
La communication comme levier de transformation comportementale
La communication joue un rôle déterminant dans la promotion de comportements favorables à la santé. Pour qu’une intervention de santé publique soit efficace, il est essentiel que les messages de prévention soient clairs, pertinents et adaptés aux attentes des personnes concernées. Les campagnes de sensibilisation, les conseils personnalisés et les programmes de formation sont autant de moyens de toucher différents publics et de les inciter à modifier leurs comportements.
Les professionnels de la santé doivent élaborer des stratégies de communication qui tiennent compte des spécificités culturelles, sociales et individuelles. Un message bien formulé, diffusé au bon moment et par le bon canal, peut faire la différence dans la prise de décision d’un individu. Par exemple, une campagne sur la réduction de la consommation d’alcool sera plus efficace si elle s’appuie sur des exemples concrets, des témoignages et des conseils pratiques adaptés à la réalité des personnes visées.
La communication ne se limite pas à l’information ; elle vise aussi à motiver, à rassurer et à accompagner les individus dans la durée. En misant sur des interventions interactives et participatives, les professionnels peuvent renforcer l’impact de leurs actions et contribuer à la prévention des maladies à l’échelle de la population.
Distinguer les nuances des transformations comportementales : au-delà de la seule volonté

Le modèle comportemental standard suppose un individu neurotypique capable de raisonner et de planifier. Or, de nombreuses conditions médicales et de santé mentale peuvent profondément altérer les piliers du changement. Ignorer ces facteurs revient à demander à quelqu’un de courir un marathon avec une jambe cassée.
Des conditions neurologiques peuvent directement impacter la “Capacité”. Un patient ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) ou porteur de tumeurs cérébrales peut souffrir de troubles des fonctions exécutives, affectant des zones comme le cortex préfrontal ventromédian ou le lobule pariétal inférieur, qui sont cruciaux pour la planification et le contrôle des impulsions. Le simple fait de “décider” de changer devient alors un immense défi neurologique, et certains événements spécifiques peuvent servir de déclenchement au processus de changement. Un diagnostic précis via un examen neurologique et une IRM du cerveau est fondamental non pas pour excuser l’inaction, mais pour adapter les stratégies.
De même, un syndrome confusionnel peut entraîner un discours désorganisé et une incapacité à suivre un plan complexe. Des hallucinations auditives peuvent perturber la concentration et la motivation. Dans ces contextes, la priorité n’est pas d’appliquer un protocole standard, mais de traiter la cause sous-jacente, qui peut être révélée par des analyses de sang pointant vers des maladies thyroïdiennes ou d’autres déséquilibres. L’usage de drogues et la consommation de substances à risque constituent un autre exemple où la capacité cognitive et la motivation sont chimiquement altérées, nécessitant une approche spécialisée.
Des facteurs apparemment mineurs peuvent aussi jouer un rôle. Le port d’aides auditives, en améliorant la communication et en réduisant l’isolement social, peut indirectement renforcer l’opportunité sociale et la motivation pour d’autres changements. À une échelle plus large, des enjeux de santé publique comme la résistance aux antibiotiques illustrent comment des comportements individuels (suivre ou non une prescription) ont des conséquences collectives et nécessitent des interventions à plusieurs niveaux, notamment par la mise en place de stratégies d’amélioration de l’utilisation des antibiotiques. D’autres situations, comme la prévention santé ou le marketing social, peuvent également nécessiter une adaptation des stratégies selon les différents types de maladies ou de comportements concernés par les obstacles au changement.
Le bien-être comme objectif central du changement
Placer le bien-être au cœur du changement de comportement permet de donner du sens et de la cohérence à l’ensemble du processus. Adopter des comportements sains ne se résume pas à éviter la maladie, mais vise avant tout à améliorer la qualité de vie, tant sur le plan physique que mental. Les facteurs qui influencent le bien-être sont multiples : une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, une bonne gestion du stress et des relations sociales épanouissantes sont autant de leviers à activer.
Les interventions de santé publique les plus efficaces sont celles qui intègrent cette vision globale du bien-être. Elles ne se contentent pas de prescrire des actions, mais accompagnent les individus dans la découverte de ce qui contribue réellement à leur épanouissement. Les professionnels de la santé ont ainsi un rôle clé à jouer pour identifier les besoins spécifiques de chaque personne et proposer des solutions adaptées.
La recherche confirme que les programmes axés sur le bien-être favorisent l’adoption de comportements durables et améliorent la santé globale. En mettant l’accent sur le bien-être, on encourage non seulement la prévention des maladies, mais aussi le développement d’une vie plus riche, plus équilibrée et plus satisfaisante pour chaque individu.
Évaluation, optimisation et pérennisation de la transformation comportementale
Le changement n'est pas un projet avec une date de fin, mais un processus dynamique de maintenance et d'ajustement. La dernière étape, souvent négligée, est cruciale pour ancrer durablement les nouvelles habitudes.
L'auto-évaluation régulière est essentielle. Cela peut prendre la forme d'un journal de bord, d'une application de suivi ou de simples bilans hebdomadaires. L'objectif est de répondre à des questions clés : le plan fonctionne-t-il ? Les bénéfices attendus sont-ils au rendez-vous ? Quels sont les nouveaux obstacles ? Cette boucle de rétroaction permet d'optimiser la stratégie en temps réel.
La gestion des rechutes est une compétence à part entière. Au lieu de voir un écart comme un échec total, il faut l'analyser comme une donnée précieuse. Pourquoi l'ancienne habitude est-elle réapparue ? Était-ce dû au stress, à un environnement particulier, à une baisse de motivation ? Comprendre le déclencheur permet d'ajuster le plan pour mieux y résister à l'avenir.
Enfin, pour pérenniser le changement, il faut qu'il devienne une partie de son identité. Le but n'est plus de "faire" une action, mais d'"être" une personne qui incarne ce comportement. C'est ici que les modèles humanistes de la psychologie, qui mettent l'accent sur la croissance personnelle et l'auto-réalisation, trouvent tout leur sens. Le changement de comportement n'est plus une corvée, mais une expression de ses valeurs et de la personne que l'on souhaite devenir. Cette intégration profonde est la meilleure garantie de durabilité.
Conclusion
Réussir un changement de comportement durable est un art qui marie la science de la psychologie à la connaissance intime de soi. Cela exige d'aller au-delà de la simple force de volonté pour devenir l'architecte de son propre parcours. Les clés du succès résident dans une approche structurée : comprendre les mécanismes fondamentaux avec des modèles comme le COM-B, construire un plan d'action personnalisé et réaliste, et surtout, faire preuve de compassion et de flexibilité face aux obstacles.
Questions fréquemment posées
Qu'est-ce que le changement de comportement ?
Le changement de comportement désigne le processus par lequel un individu modifie ses habitudes, attitudes ou pratiques, souvent pour améliorer sa santé, son bien-être ou sa qualité de vie. Ce processus est influencé par des facteurs psychologiques, sociaux et environnementaux.
Pourquoi le changement de comportement est-il difficile à maintenir ?
Le maintien d'un changement de comportement est complexe car il nécessite une motivation constante, un environnement favorable et la capacité de surmonter les obstacles et les rechutes. De plus, les habitudes anciennes sont souvent profondément ancrées, ce qui demande du temps et de la persévérance pour les remplacer.
Quels sont les modèles les plus efficaces pour comprendre le changement de comportement ?
Parmi les modèles reconnus, le Modèle Transthéorique (Étapes du Changement) et le modèle COM-B sont particulièrement utilisés. Ils permettent de comprendre les différentes phases du changement et les facteurs nécessaires pour adopter et maintenir un nouveau comportement.
Comment la santé mentale influence-t-elle le changement de comportement ?
La santé mentale joue un rôle crucial dans la capacité à initier et maintenir un changement. Des troubles comme la dépression ou l'anxiété peuvent diminuer la motivation et la capacité à gérer les obstacles, rendant l'accompagnement adapté indispensable.
Quel rôle joue l'environnement dans le changement de comportement ?
L'environnement, qu'il soit physique ou social, peut faciliter ou freiner le changement. Par exemple, un cadre de vie propice, un soutien social ou des ressources accessibles augmentent les chances de succès.
Comment élaborer un plan d'action efficace pour un changement durable ?
Un plan d'action doit être clair, spécifique, réaliste et adapté à l'individu. Il doit inclure une identification précise des objectifs, des étapes concrètes, un suivi régulier et des stratégies pour gérer les difficultés.
Quelle est l'importance de la communication dans le changement de comportement ?
La communication est un levier essentiel pour informer, motiver et accompagner les individus. Des messages adaptés, clairs et personnalisés renforcent l'engagement et facilitent l'adoption de nouvelles pratiques.
Contenu original de l'équipe de rédaction d'Upbility. La reproduction de cet article, en tout ou en partie, sans mention de l'éditeur est interdite.
Références
-
Michie, S., van Stralen, M. M., & West, R. (2011). The behaviour change wheel: A new method for characterising and designing behaviour change interventions. Implementation Science, 6, 42. https://doi.org/10.1186/1748-5908-6-42
-
Prochaska, J. O., & DiClemente, C. C. (1983). Stages and processes of self-change of smoking: Toward an integrative model of change. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 51(3), 390–395. https://doi.org/10.1037/0022-006X.51.3.390
-
West, R., Michie, S., Rubin, G. J., & Amlôt, R. (2020). Applying principles of behaviour change to reduce SARS-CoV-2 transmission. Nature Human Behaviour, 4(5), 451–459. https://doi.org/10.1038/s41562-020-0887-9
-
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2008). Self-determination theory: A macrotheory of human motivation, development, and health. Canadian Psychology, 49(3), 182–185. https://doi.org/10.1037/a0012801
-
Organisation mondiale de la santé (OMS). (2014). Rapport sur la santé dans le monde : Prévention des maladies chroniques. https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases
-
Barker, F., Atkins, L., & de Lusignan, S. (2016). Applying the COM-B behaviour model and behaviour change wheel to develop an intervention to improve hearing aid use in adult auditory rehabilitation. International Journal of Audiology, 55(sup3), S90–S98. https://doi.org/10.1080/14992027.2016.1219772
-
Sheeran, P. (2002). Intention—behavior relations: A conceptual and empirical review. European Review of Social Psychology, 12(1), 1–36. https://doi.org/10.1080/14792772143000003
-
Mazéas, A. (2021). Qu’est-ce-qui influence nos changements de comportements ? Kiplin. https://www.kiplin.com/fr/blog/sante-au-travail/influence-changements-de-comportements
-
Action contre la Faim. (s.d.). Accompagnement au changement de comportement. https://www.actioncontrelafaim.org/publication/accompagnement-au-changement-de-comportement
-
IDS Media. (2021). Prévention santé : la communication pour un changement de comportement. https://www.ids-media.fr/blog/prevention-sante-communication-changement-comportement