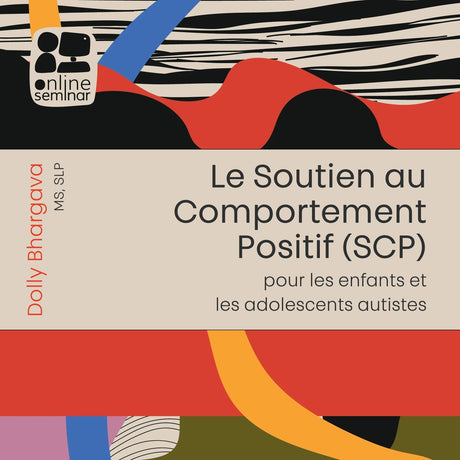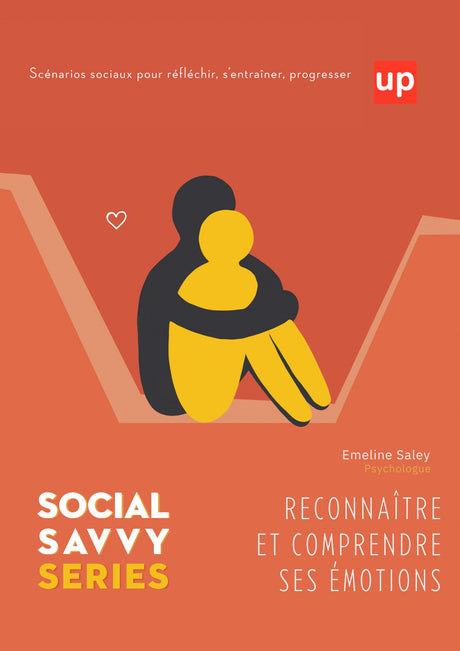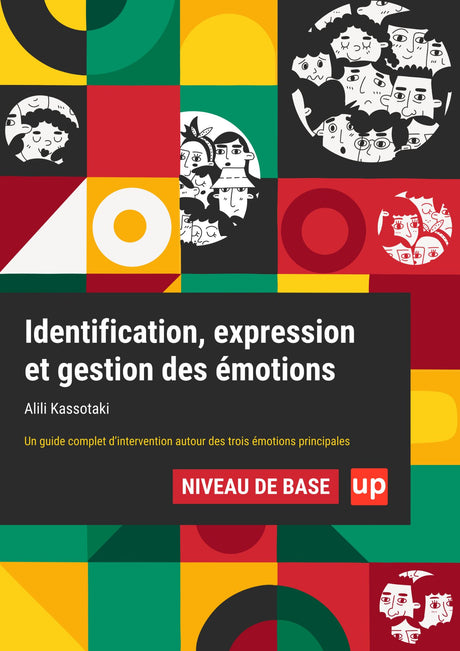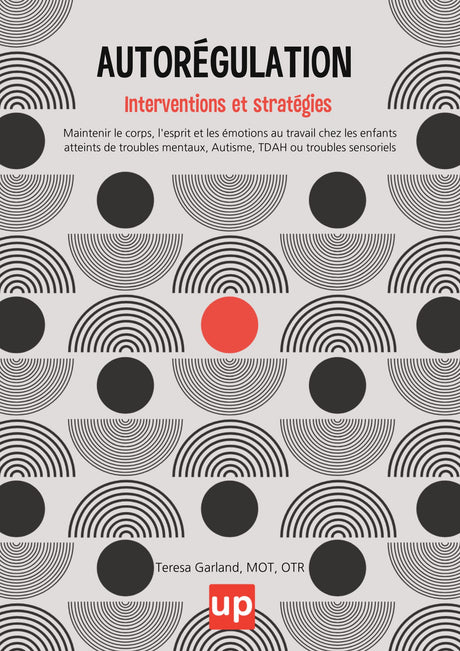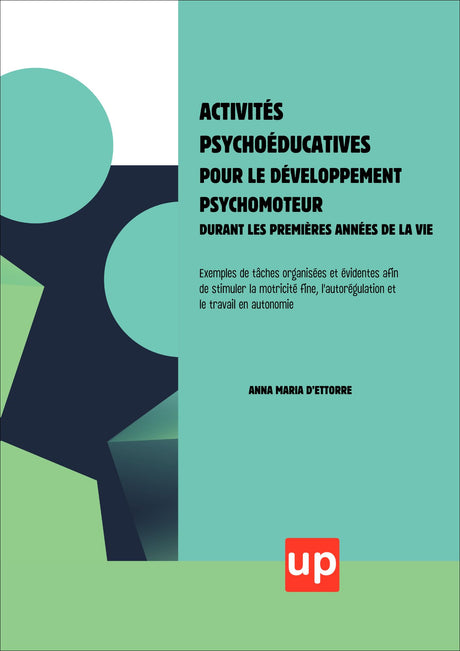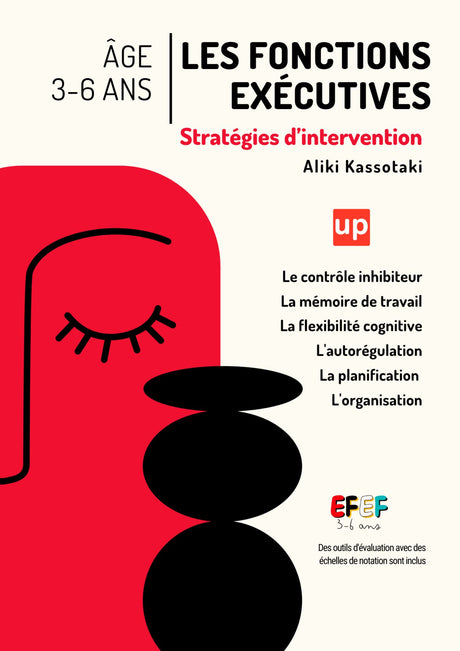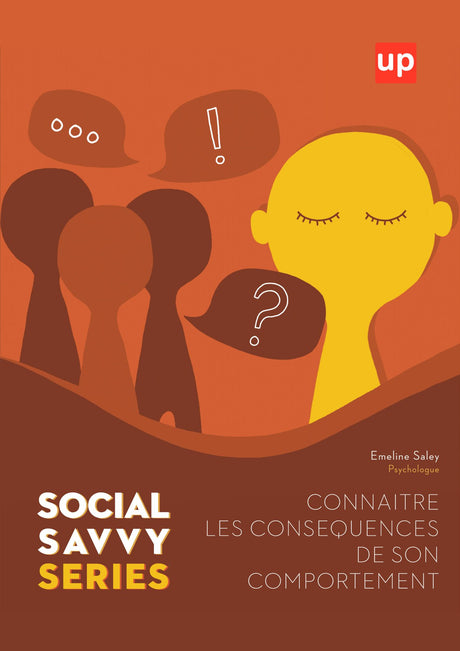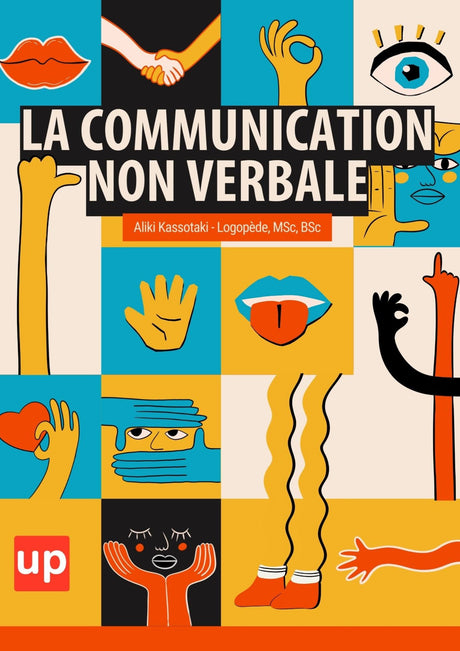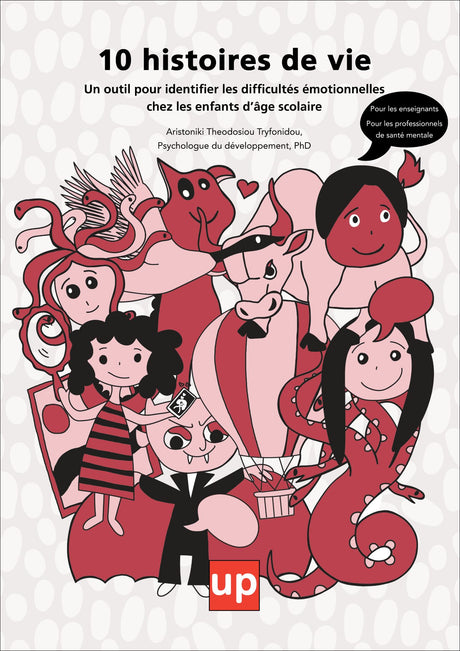Le discours, reflet de notre pensée, peut parfois prendre des chemins sinueux, rendant la communication complexe et difficile. Imaginez une conversation où votre interlocuteur, au lieu d'aller droit au but, tourne autour du sujet, accumulant les détails et les digressions. C'est l'essence même du discours circonlocutoire, un phénomène qui, bien que parfois présent chez des individus sans trouble mental particulier, peut être le symptôme de troubles psychiatriques sous-jacents. Cet article explore en profondeur ce type de discours, ses enjeux, ses liens avec d'autres troubles de la pensée et, surtout, propose des solutions pratiques pour mieux le comprendre et le gérer. Nous aborderons la sémiologie psychiatrique qui l'encadre, les manifestations cliniques et les facteurs contributifs, ainsi que les stratégies d'identification et d'intervention pour les professionnels, les proches et les personnes concernées.
Points Clés
- Le discours circonlocutoire se caractérise par un langage détourné et prolixe qui complique la communication en éloignant l’attention de l’objectif principal.
- Ce type de discours est fréquemment observé dans des troubles psychiatriques tels que la schizophrénie ou les troubles de l’humeur, mais peut aussi apparaître dans des contextes de stress ou de fatigue.
- La reconnaissance et la gestion du discours circonlocutoire reposent sur une évaluation attentive, une écoute active et des stratégies adaptées pour améliorer la clarté et l’efficacité de la communication.
Introduction à la Sémiologie Psychiatrique et au Discours Circonlocutoire

La sémiologie psychiatrique, l’étude des signes et symptômes des troubles mentaux, offre un cadre essentiel pour comprendre le discours circonlocutoire. Le terme 'discours circonlocutoire' désigne une expression verbale particulière : il s'agit d'une def expression caractérisée par une manière de s'exprimer longue, complexe et détournée, qui complique la communication et le comportement discursif. Ce dernier se caractérise par une incapacité à aller directement au but de la conversation, l’individu “tournant autour du pot” avant d’aborder, parfois même sans jamais l’atteindre, le sujet principal. Il est important de le situer dans le paysage plus large des troubles de la pensée et de l’expression verbale, afin d’éviter les confusions et de poser un diagnostic précis. L’étude du discours circonlocutoire s’inscrit également dans le champ de la psychologie, qui permet de mieux comprendre les mécanismes sous-jacents à ce type de trouble.
Comprendre le Discours Circonlocutoire : Définition et Caractéristiques Fondamentales
Le discours circonlocutoire est défini par une expression verbale excessivement détaillée, où l’individu s’éloigne du sujet principal et détourne l'attention de l'objectif principal du message par des digressions et des détails de second ordre, rendant la communication inefficace et parfois frustrante pour l’interlocuteur.
Contrairement à la simple prolixité, où le discours est abondant mais reste centré sur le sujet, le discours circonlocutoire perd le fil conducteur et rend difficile l’identification du message principal. Ce type de discours multiplie les propositions, ce qui complexifie la structure et la logique du propos. La personne concernée peut avoir conscience du sujet initial, mais peine à l’atteindre directement.
De plus, le discours circonlocutoire s'accompagne souvent d'explications longues et détournées qui compliquent la compréhension.
Distinction et Relation avec d'autres Troubles du Discours et de la Pensée
Il est crucial de distinguer le discours circonlocutoire d’autres troubles du discours et de la pensée. Le discours tangentiel, par exemple, s’éloigne également du sujet principal, mais ne revient jamais à celui-ci, contrairement au discours circonlocutoire qui, malgré les détours, peut finalement y revenir. Le cours des troubles du langage peut varier selon le contexte clinique, influençant la présentation et l’évolution des symptômes observés. Le relâchement des associations, quant à lui, se caractérise par une perte des liens logiques entre les idées et une incohérence des propos, tandis que dans le discours circonlocutoire, le lien logique, bien que masqué par la prolixité, peut subsister. L’association par assonance, où les mots sont liés par leur sonorité plutôt que par leur sens, peut également être présente, ajoutant à la complexité du discours. Il est important de noter que la fuite des idées, caractéristique d’états maniaques, se distingue du discours circonlocutoire par son débit accéléré et le changement rapide de sujet, bien que les deux puissent coexister. On observe aussi la pensée diffluente, proche du relâchement des associations, où le discours est vague et imprécis. Dans certains cas, une diminution de la clarté ou de la cohérence du discours peut être observée, compliquant davantage l’évaluation clinique.
Manifestations et Contextes Cliniques du Discours Circonlocutoire
Le départ d’un épisode clinique marqué par le discours circonlocutoire s’accompagne souvent d’une modification notable du comportement verbal et non verbal. Le discours circonlocutoire peut se manifester dans divers contextes cliniques et être associé à différents troubles. Il est fréquemment observé dans la schizophrénie, où la désorganisation des pensées et les troubles de l’expression verbale sont des symptômes courants. L’alogie, caractérisée par une diminution de la production verbale ou de la richesse du discours, peut également être présente dans ce contexte. Il peut également apparaître dans les troubles de l’humeur, notamment lors d’épisodes dépressifs ou maniaques, où l’humeur globale influence la tonalité du discours. Dans ce dernier cas, le discours circonlocutoire peut s’accompagner d’une agitation verbale et d’un débit accéléré (tachypsychie). Cette agitation verbale s’accompagne souvent d’une augmentation de l’activité motrice et d’une tension intérieure, traduisant une nervosité ou une anxiété sous-jacente. L’expression du visage peut alors être altérée, avec une perte ou une augmentation des mimiques, reflétant l’état émotionnel du patient.
Les troubles anxieux, comme les crises d’angoisse ou les attaques de panique, peuvent aussi influencer le discours, le rendant plus indirect et circonlocutoire. L’anxiété, notamment l’anxiété de séparation ou l’anxiété anticipatoire, module la forme et le contenu du discours. Parfois, des manifestations neurovégétatives, telles que la transpiration ou les palpitations, accompagnent ce discours, reflétant l’anxiété sous-jacente. La qualité des réponses lors d’un épisode de discours circonlocutoire peut être altérée, avec des réponses imprécises ou inadaptées au contexte.
Des troubles plus spécifiques, comme la phobie des hauteurs ou le comportement d’achat incontrôlé, peuvent également entraîner un discours circonlocutoire, l’individu cherchant à éviter ou à justifier ses comportements. Dans ces cas, le besoin irrépressible d’éviter une situation ou de satisfaire une compulsion se traduit par un discours détourné. Même le sevrage en alcool peut perturber le discours, le rendant parfois incohérent et circonlocutoire.
Enfin, dans certains cas, le discours peut refléter un délire paranoïde, où le récit délirant s’exprime de manière indirecte et allusive. Il est fréquent que quelqu’un parle d’une tierce personne de façon détournée, sans la nommer directement, dans ce type de discours. Face à une situation stressante ou à la perte d’un être cher, le discours circonlocutoire peut traduire la difficulté à exprimer directement ses émotions ou ses pensées. Il est important de souligner que le syndrome catatonique, caractérisé par une immobilité et un mutisme, peut parfois précéder ou suivre des périodes d’agitation verbale et de discours circonlocutoire.
Étiologies et Facteurs Contributifs au Discours Circonlocutoire
Les causes du discours circonlocutoire sont multiples et complexes. Des facteurs génétiques et neurobiologiques peuvent jouer un rôle, notamment dans les troubles psychiatriques comme la schizophrénie. Le cours évolutif de ces troubles peut influencer la manifestation et la progression du discours circonlocutoire au fil du temps. Des facteurs psychologiques, tels que les problèmes émotionnels non résolus ou les traumatismes passés, peuvent également contribuer à ce type de discours. Dans certains cas, le discours circonlocutoire peut être une stratégie d’évitement, l’individu cherchant inconsciemment à éviter des sujets douloureux ou anxiogènes. Enfin, des facteurs environnementaux, comme le stress ou la fatigue, peuvent entraîner une diminution de la clarté et de la fluidité du discours, le rendant plus circonlocutoire.
Le terme « discours circonlocutoire » est fréquemment utilisé dans la littérature spécialisée pour décrire ce phénomène dans un contexte clinique et psychologique.
L’Expression de Soi dans la Sémiologie Psychiatrique

L’expression de soi occupe une place centrale dans la sémiologie psychiatrique, car elle permet d’explorer la manière dont un individu formule ses pensées, ses émotions et ses expériences à travers le langage. Dans le domaine de la psychiatrie, l’analyse du discours, de la communication et du langage offre des indices précieux sur la présence de troubles mentaux ou de difficultés psychologiques sous-jacentes.
Le discours circonlocutoire illustre parfaitement la complexité de l’expression de soi en contexte clinique. Ce type de discours se caractérise par une augmentation notable de la production verbale, où le locuteur multiplie les déclarations, les remarques incidentes et les détails accessoires, au point de détourner l’attention du sujet principal. Cette prolixité peut durer plusieurs minutes, surtout si l’interlocuteur n’intervient pas pour recentrer la conversation sur l’essentiel. Ce phénomène n’est pas uniquement le reflet d’une désorganisation de la pensée ; il peut aussi traduire une stratégie d’évitement, l’individu cherchant à contourner des sujets ou des émotions difficiles, comme la colère, la tristesse ou l’anxiété.
Les exemples de discours circonlocutoire sont variés. Par exemple, au lieu d’exprimer directement une émotion (“je suis en colère contre ma mère”), une personne pourra multiplier les détours (“j’ai des problèmes avec ma famille, il y a beaucoup de tensions en ce moment, et parfois je me sens incompris…”), rendant le message moins explicite. Ce type de communication peut être observé dans de nombreux troubles mentaux, notamment la schizophrénie, où la désorganisation de la pensée et du langage est fréquente, mais aussi dans la dépression, où l’expression des émotions est souvent indirecte. Il n’est pas rare non plus de retrouver ce mode d’expression chez des personnalités de type obsessionnel-compulsif, qui ont tendance à s’attarder sur les détails et à éviter les affirmations tranchées.
Cependant, il est important de souligner que le discours circonlocutoire n’est pas toujours le signe d’un trouble mental. Dans certains cas, il peut simplement refléter une fatigue, un stress passager ou une difficulté ponctuelle à organiser ses pensées. La recherche en psychiatrie s’intéresse d’ailleurs à ces variations, afin de mieux distinguer ce qui relève d’une pathologie de ce qui appartient à la diversité normale de l’expression humaine.
En définitive, l’expression de soi, à travers le discours et le langage, constitue un outil d’évaluation essentiel en psychiatrie. L’observation attentive des modifications du discours, de la prolixité, de la désorganisation ou de l’évitement de certains sujets permet de mieux comprendre les manifestations des troubles mentaux et d’adapter l’accompagnement thérapeutique à chaque individu. L’étude du discours circonlocutoire, en particulier, offre un éclairage précieux sur la façon dont les pensées et les émotions s’articulent dans la communication, que ce soit en présence d’un trouble ou dans le cadre d’une expérience psychologique singulière.
Identification et Évaluation Clinique du Discours Circonlocutoire
L’identification et l’évaluation clinique du discours circonlocutoire reposent sur une observation attentive de l’attention du patient et des stratégies d’entretien rigoureuses. L’évaluation doit également vérifier si le discours reste centré sur l’objectif principal afin d’éviter la dispersion et de garantir l’efficacité de la communication. L’expérience globale du patient est également essentielle pour comprendre les facteurs sous-jacents à ce trouble. Enfin, la prise en compte des interlocuteurs est essentielle dans l’évaluation clinique.
Critères d'observation précis pour le clinicien
Le clinicien doit être attentif à la quantité de détails superflus, à la difficulté à atteindre le sujet principal et à la présence d’associations inhabituelles entre les idées. L’observation des troubles psychomoteurs et de l’altération de la motivation peut également fournir des indices précieux. Il est important d'observer l'activité motrice du patient, notamment l'augmentation ou la diminution de l'activité, qui peut se manifester par de l'hyperactivité, de l'agitation ou au contraire une réduction des mouvements. L'évaluation de la gravité des troubles du discours circonlocutoire permet de mieux apprécier l'impact fonctionnel sur la communication. Enfin, l'observation du visage et des mimiques lors de l'entretien clinique aide à détecter d'éventuelles anomalies de l'expression émotionnelle ou des mimiques déformantes.
Stratégies d'entretien rigoureuses pour évaluer le discours
Des questions ouvertes et des reformulations permettent d’explorer la pensée du patient et d’identifier les schémas de discours circonlocutoires. L’analyse des réponses du patient permet d’évaluer la cohérence du discours. Il est également essentiel de demander des explications précises au patient afin de mieux comprendre la nature de ses propos circonlocutoires. Il est important de créer un climat de confiance pour encourager le patient à s’exprimer librement.
L'importance de l'expérience globale et subjective du patient
Comprendre comment le patient perçoit son propre discours et les difficultés qu’il rencontre est essentiel pour adapter la prise en charge. L’humeur du patient, qu’elle soit élevée (hyperthymie), basse (hypothymie) ou neutre (euthymie), peut influencer la forme et le contenu de son discours. Certains patients peuvent ressentir un besoin impérieux et irrépressible de s’exprimer, ce qui peut orienter l’analyse clinique. L’exploration des émotions et des pensées associées au discours permet d’identifier les facteurs contributifs.
Distinguer le discours circonlocutoire d'autres formes de communication complexes ou culturellement influencées
Certaines formes de communication, riches en métaphores ou en allusions, peuvent ressembler à un discours circonlocutoire. Il est crucial de tenir compte du contexte culturel et des habitudes de langage de l’individu pour éviter les diagnostics erronés.
La structure des propositions dans le discours peut varier selon les cultures, influençant la manière dont les idées sont organisées et exprimées.
De plus, le cours des habitudes de communication évolue au fil du temps et selon les contextes culturels, ce qui peut modifier la façon dont le discours est perçu ou interprété.
L'intégration des manifestations neurovégétatives comme indicateurs contextuels pertinents
L’observation des manifestations neurovégétatives, comme la transpiration ou les tremblements, peut aider à identifier l’anxiété ou le stress qui peuvent accompagner et influencer le discours circonlocutoire.
Une tension émotionnelle importante est fréquemment présente, se manifestant par une nervosité intérieure qui accompagne le discours circonlocutoire.
On peut également observer une activité motrice excessive, telle que des gestes répétitifs ou une agitation, lors des épisodes de discours circonlocutoire.
Gestion et Stratégies d'Intervention

La gestion du discours circonlocutoire nécessite une approche multidisciplinaire, impliquant des professionnels de la santé, des proches et la personne concernée. La psychologie joue un rôle central dans la compréhension et la gestion de ce trouble, notamment à travers la psychoéducation et la gestion des émotions. Dans certains contextes thérapeutiques, des méthodes comme la DBS (en anglais) peuvent également être envisagées pour compléter la prise en charge. Il est essentiel d’assurer un départ précoce de la prise en charge afin d’optimiser les résultats et d’améliorer la progression globale.
Pour le professionnel, l’écoute active, la reformulation et le recadrage doux de la conversation sont essentiels. Des outils d’évaluation standardisés peuvent aider à quantifier le trouble et à suivre son évolution. Les proches peuvent apprendre des techniques de communication adaptées, encourager l’expression claire et offrir un soutien émotionnel. Pour la personne concernée, l’auto-observation, les techniques de pleine conscience et des exercices de structuration de la pensée peuvent être bénéfiques. Les thérapies comportementales et cognitives (TCC) peuvent aider à identifier et à modifier les schémas de pensée qui contribuent au discours circonlocutoire. L’orthophonie peut également être utile pour améliorer la fluidité et la clarté de l’expression verbale.
Les enjeux du discours circonlocutoire sont importants, impactant la communication interpersonnelle, la vie professionnelle et les relations sociales. L’inefficacité de la communication peut engendrer des pertes financières importantes pour les entreprises. De plus, 86 % des collaborateurs pointent du doigt les lacunes en communication comme cause majeure d’échecs professionnels. Une communication claire est pourtant perçue comme un facteur clé de la productivité, soulignant l’importance d’adresser le discours circonlocutoire. Le manque de clarté dans les instructions et dans les réunions peut également être lié à ce type de discours, entraînant confusion et frustration. Enfin, le manque de capacité décisionnelle chez certains managers peut être aggravé par un discours circonlocutoire, rendant la prise de décision plus complexe.
Conclusion
Comprendre le discours circonlocutoire, ses nuances et ses enjeux, est essentiel pour améliorer la communication et la qualité de vie des personnes concernées. Il ne s’agit pas simplement d’un “défaut” de communication, mais d’un symptôme qui peut révéler des troubles sous-jacents. Il est important d'utiliser le terme approprié pour décrire le discours circonlocutoire, afin de clarifier la nature du trouble et d'adapter l'approche thérapeutique. La psychologie joue un rôle central dans la compréhension et la gestion de ce trouble, notamment à travers la psychoéducation et l'analyse des processus cognitifs impliqués. Une approche empathique, une évaluation rigoureuse et des stratégies d’intervention adaptées permettent de mieux gérer ce trouble et d’améliorer l’expérience globale de l’individu. Des recherches plus approfondies sur les mécanismes neurocognitifs et l’efficacité des différentes thérapies sont nécessaires pour optimiser la prise en charge du discours circonlocutoire. En fin de compte, l’objectif est de favoriser une communication plus claire, plus directe et plus authentique.
Questions fréquemment posées
Qu'est-ce que le discours circonlocutoire ?
Le discours circonlocutoire est une manière d'expression verbale caractérisée par des détours, des digressions et une abondance de détails qui éloignent l'attention du sujet principal, rendant la communication moins claire et parfois difficile à suivre.
Dans quels contextes le discours circonlocutoire apparaît-il généralement ?
Il est souvent observé dans des troubles psychiatriques tels que la schizophrénie, les troubles de l'humeur, mais peut aussi survenir en cas de stress, de fatigue ou d'anxiété, ainsi que dans certaines situations émotionnelles complexes.
Comment différencier le discours circonlocutoire d'autres troubles du langage ?
Contrairement au discours tangentiel, le discours circonlocutoire revient finalement au sujet principal malgré les détours. Il se distingue aussi du relâchement des associations par le maintien d'un lien logique, bien que masqué.
Quels sont les signes cliniques à observer pour identifier ce type de discours ?
On observe une prolixité excessive, des détails superflus, une difficulté à atteindre le but de la conversation, ainsi que parfois des manifestations neurovégétatives comme la nervosité ou l'agitation.
Comment peut-on gérer ou intervenir face à un discours circonlocutoire ?
La gestion implique une écoute active, des reformulations, la psychoéducation, et éventuellement des thérapies comportementales et cognitives. L'orthophonie peut également aider à améliorer la clarté de l'expression.
Le discours circonlocutoire est-il toujours un signe de trouble mental ?
Non, il peut aussi refléter des situations passagères comme la fatigue, le stress ou une difficulté temporaire à organiser ses pensées, sans qu'il y ait nécessairement un trouble psychiatrique sous-jacent.
Quel est l'impact du discours circonlocutoire sur la communication professionnelle ?
Il peut entraîner des incompréhensions, une perte de temps, une baisse de productivité et des difficultés dans la prise de décision, soulignant l'importance d'une communication claire dans le milieu professionnel.
Contenu original de l'équipe de rédaction d'Upbility. La reproduction de cet article, en tout ou en partie, sans mention de l'éditeur est interdite.
Références
-
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5e éd.). Washington, DC: APA Publishing.
-
Andreasen, N. C. (1979). Thought, language, and communication disorders: Clinical assessment, definition of terms, and evaluation of their reliability. Archives of General Psychiatry, 36(12), 1315-1321.
-
Bleuler, E. (1911). Dementia Praecox or the Group of Schizophrenias. New York: International Universities Press.
-
Berrios, G. E. (1991). The history of mental symptoms: Descriptive psychopathology since the nineteenth century. Cambridge University Press.
-
Kaplan, H. I., & Sadock, B. J. (2015). Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry (11e éd.). Wolters Kluwer.
-
Liddle, P. F. (1987). The symptoms of chronic schizophrenia. A re-examination of the positive-negative dichotomy. The British Journal of Psychiatry, 151(6), 145-151.
-
Maher, B. A. (1988). Delusional thinking and perceptual disorder. The Journal of Nervous and Mental Disease, 176(8), 498-505.