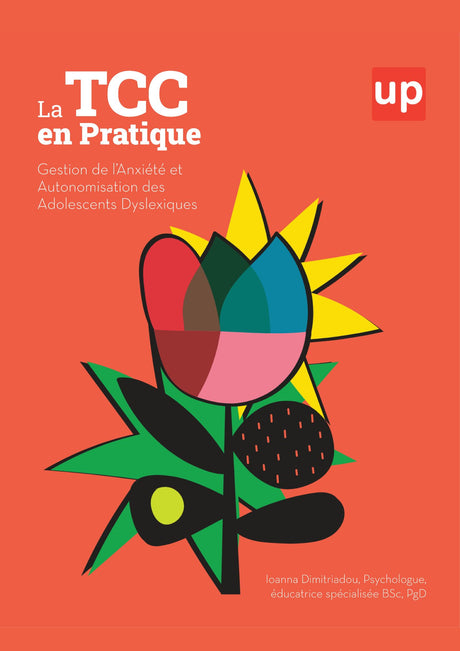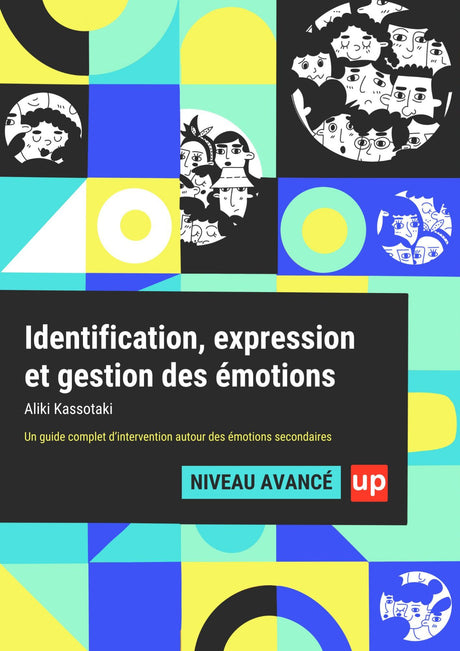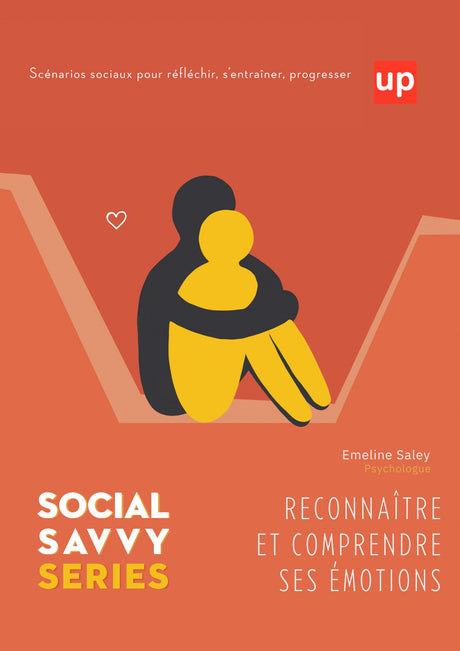De plus en plus de personnes découvrent à l'âge adulte qu'elles se situent sur le spectre de l'autisme, ce qui remet en question de nombreuses compréhensions antérieures de cette condition. Autrefois perçu comme un trouble exclusivement diagnostiqué chez l'enfant, l'autisme commence à être mieux appréhendé chez les adultes grâce à une sensibilisation accrue et à un accès élargi aux ressources de diagnostic. Ce phénomène suscite une question intrigante : devient-on réellement autiste à l'âge adulte ou s'agit-il d'une reconnaissance tardive de caractéristiques existantes depuis longtemps ?
Points Clés
- L’autisme est un trouble neuro-développemental présent dès la naissance, mais peut être diagnostiqué tardivement à l’âge adulte.
- Les adultes autistes peuvent présenter des symptômes subtils ou atypiques, rendant le diagnostic complexe sans prise en charge adaptée.
- Un diagnostic tardif favorise une meilleure compréhension de soi et un accès à des ressources essentielles pour améliorer la qualité de vie.
Peut-on Devenir Autiste? : Introduction à l'Autisme et à ses Manifestations

L’autisme, ou Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA), est un trouble neuro-développemental complexe. Selon la définition médicale, il s'agit d'un trouble du développement neurologique qui affecte la communication, les interactions sociales et les comportements. L’autisme fait partie du spectre de l’autisme, également appelé spectre de l’autisme TSA, ce qui signifie qu’il existe une grande diversité de manifestations et de degrés d’atteinte. Au fil du temps, les termes et la terminologie utilisés pour désigner l’autisme ont évolué, passant de TED à TSA, reflétant une meilleure compréhension de la diversité des troubles. Ce trouble du neuro développement est présent dès la naissance et concerne aussi bien les bébés que les enfants. Chaque année, de nombreux bébés naissent avec un trouble du spectre de l’autisme, ce qui souligne l’importance de la prévalence des naissances concernées par cette condition. Le diagnostic de l’autisme chez l’enfant est souvent posé dans les premières années de vie, permettant une prise en charge précoce.
Il est caractérisé par des atypies cérébrales et affecte environ 700 000 personnes en France, représentant environ 1% de la population mondiale. L’autisme est lié à des particularités du cerveau, notamment une organisation et une connectivité neuronale atypiques qui perturbent le fonctionnement cérébral. Les signes de l’autisme se manifestent souvent avant l’âge de 3 ans.
Manifestations de l'autisme
- Interactions sociales : Difficultés à établir des relations sociales.
- Communication : Problèmes de communication verbale et non verbale.
- Comportements : Présence de comportements stéréotypés et répétitifs.
- Intérêts : Intérêts souvent restreints et fixations sur des sujets spécifiques.
- Sensibilité sensorielle : Réactions inhabituelles aux stimuli sensoriels.
La contribution génétique est notable, avec plus de 200 gènes associés identifiés.
Présentation des symptômes par catégories
|
Catégorie |
Manifestations |
|---|---|
|
Interactions sociales |
Difficulté à établir des relations |
|
Communication |
Verbal et non verbal altérés |
|
Comportements |
Stéréotypés et répétitifs |
|
Intérêts |
Restreints et spécifiques |
|
Sensibilité sensorielle |
Réactions inhabituelles aux stimuli |
Ces symptômes, souvent variés, requièrent une compréhension approfondie et une prise en charge adaptée pour améliorer la qualité de vie des individus autistes.
Les signes de l'autisme chez l'adulte

L'autisme est généralement détecté pendant l'enfance, souvent avant l'âge de 3 ans. Cependant, chez certains individus, les signes du Trouble du Spectre de l'Autisme (TSA) ne sont reconnus que plus tard dans la vie. Cela peut être dû à un diagnostic manqué ou tardif pendant l'enfance, souvent parce que les symptômes initiaux n'étaient pas suffisamment marqués ou ont été confondus avec d'autres traits psychologiques. Bien que l'autisme ne se développe pas à l'âge adulte, il devient parfois apparent lorsque les exigences environnementales dépassent les capacités sociales de la personne. Un diagnostic d'autisme à l'âge adulte doit être mené avec soin pour ne pas le confondre avec d'autres troubles tels que le trouble de la personnalité schizoïde. L'absence de déficience intellectuelle et de bonnes compétences de communication verbale peuvent parfois masquer les signes de l'autisme, ce qui retarde davantage le diagnostic.
Intérêts restreints
Chez les adultes autistes, les intérêts restreints peuvent se manifester de manière unique et parfois atypique. Ces intérêts peuvent inclure des objets spécifiques tels que les moteurs électriques, les sacs poubelles ou les panneaux de circulation. Ces passions peuvent avoir un aspect compulsif, où l’individu répète certains mouvements ou prononce des mots spécifiques de manière répétitive.
Certaines personnes autistes développent des intérêts restreints avec une intensité remarquable. Par exemple, une fascination pour les lumières, les ventilateurs ou les objets tournants peut captiver leur attention pendant de longues périodes. Ces intérêts peuvent également créer un attachement excessif à certains objets, rendant difficile leur séparation d’un tournevis jouet ou d’un bouton, par exemple.
Ces intérêts restreints ne se limitent pas à être une simple curiosité; ils servent souvent de source de réconfort. Dans des moments de stress ou de tristesse, s’investir dans ces passions peut aider à gérer des émotions telles que l’anxiété, fournissant un espace sûr et familier dans un monde parfois imprévisible.
Il est donc essentiel de proposer des activités adaptées aux intérêts des adultes autistes afin de favoriser leur inclusion sociale et le développement de leur autonomie.
Communication sociale déficiente
La communication sociale est un domaine où les adultes autistes rencontrent souvent des défis significatifs. Ces défis incluent fréquemment des difficultés à établir et maintenir un contact visuel, un élément essentiel dans les interactions sociales. L’absence de contact visuel ou son caractère fuyant peut rendre les échanges interpersonnels plus complexes et moins fluides.
La communication non verbale est également problématique, car elle entrave la capacité à comprendre et à exprimer des émotions à travers les expressions faciales ou le langage corporel. Cela complique la lecture des intentions et des émotions des autres, rendant parfois les interactions sociales déroutantes et éprouvantes.
De plus, les adultes autistes tendent à interpréter les mots littéralement, ayant des difficultés à saisir des concepts tels que l’humour ou le sarcasme. Cette prise de parole directe, bien que honnête, peut être perçue comme un manque d’empathie, ce qui affecte la construction et le maintien de relations. Ces limitations créent un fossé dans la communication, nécessitant souvent une intervention spécialisée pour améliorer les interactions et enrichir les relations personnelles. Ces difficultés de communication peuvent ainsi entraver la création et le maintien de liens sociaux.
Le diagnostic de l'autisme à l'âge adulte

Beaucoup d’adultes découvrent leur autisme tardivement, souvent parce que les symptômes n’ont pas été clairement identifiés durant leur enfance. Le diagnostic implique souvent de répondre à des questions ciblées sur le fonctionnement depuis l’enfance, afin d’explorer les aspects cognitifs, sensoriels et sociaux. Les manifestations principales peuvent avoir été confondues avec de la timidité ou de l’anxiété, empêchant un diagnostic précoce. À l’âge adulte, l’autisme ne peut pas apparaître à proprement parler, mais les avancées en matière de dépistage permettent aujourd’hui de diagnostiquer plus efficacement les adultes, souvent après une prise de conscience de traits autistiques qui n’étaient pas reconnus auparavant. Un diagnostic tardif est souvent rendu possible chez les personnes qui possèdent un niveau cognitif équivalent à la moyenne et une communication verbale adéquate sans déficience intellectuelle. Les professionnels de santé jouent un rôle clé dans ce processus ; l’analyste du comportement, en particulier, intervient dans l’évaluation et le diagnostic en identifiant les symptômes atypiques et en proposant une analyse approfondie. L’autisme est un trouble neurobiologique qui se manifeste généralement avant l’âge de 3 ans, mais un diagnostic peut être posé bien plus tard à la suite de l’évolution des symptômes ou d’une meilleure compréhension des manifestations autistiques chez l’adulte. Il est essentiel d’assurer la mise en place rapide d’une intervention ou d’un accompagnement adapté après le diagnostic pour favoriser le développement de la personne. Enfin, des stratégies d’apprentissages personnalisées sont indispensables pour accompagner efficacement les adultes autistes dans leur quotidien.
Processus de dépistage et tests standardisés
Le processus de dépistage pour diagnostiquer l’autisme repose sur une évaluation clinique multidimensionnelle. Cette évaluation est individualisée et prend en compte différents aspects du développement et du fonctionnement de l’individu, ainsi que son environnement. Il n’existe pas de test biologique spécifique pour l’autisme; le diagnostic s’appuie sur un ensemble d’observations des enjeux comportementaux par les parents et les professionnels de la santé. Il est essentiel que le type d’évaluation et d’accompagnement soit adapté au profil individuel de chaque personne autiste afin de répondre au mieux à ses besoins spécifiques.
Lors du diagnostic, une attention particulière est portée aux interactions sociales, à la communication et aux comportements répétitifs. Une équipe pluridisciplinaire spécialisée, composée de professionnels formés, collabore avec la famille pour établir un diagnostic d’autisme, en utilisant leur expertise dans le domaine. Diagnostiquer l’autisme le plus précocement possible, idéalement dès l’âge de 18 mois, assure une prise en charge mieux adaptée et plus bénéfique pour le développement de l’enfant.
Importance des antécédents développementaux
L’autisme est catégorisé comme un trouble du neurodéveloppement qui apparaît avant l’âge de 36 mois. Les troubles du spectre de l’autisme (TSA) impliquent des atypies cérébrales dès la naissance, ce qui influence la perception et la compréhension du monde chez la personne autiste. Dès le jeune âge, les signes de l’autisme incluent des altérations dans la communication sociale et les interactions, qui ont un impact durable tout au long de la vie.
Pour un diagnostic et une intervention efficaces, il est crucial d’identifier l’autisme le plus précocement possible, idéalement pendant la petite enfance. Bien que le diagnostic puisse être retardé, les causes de ce trouble sont présentes dès la naissance. Ce processus est essentiel pour mettre en place des stratégies d’intervention qui favorisent le développement optimal de l’individu concerné. Il existe ainsi un lien direct entre la détection précoce des manifestations de l’autisme et la mise en œuvre d’un accompagnement adapté.
Facteurs déclencheurs d'un diagnostic tardif
Les symptômes de l’autisme peuvent souvent passer inaperçus jusqu’à l’âge adulte. Ceci est notamment dû à des erreurs de diagnostic pendant l’enfance, ou lorsque l’autisme est léger et ne correspond pas clairement à tous les critères diagnostiques. Un diagnostic tardif est souvent favorisé par la variabilité des symptômes et des comorbidités, qui peuvent masquer les signes typiques de l’autisme.
L’évolution des critères diagnostiques, comme leur mise à jour en 2022 dans le DSM5, a également contribué à des diagnostics tardifs chez les adultes. En outre, le manque de formation et d’expérience en matière de reconnaissance des signes d’autisme chez les adultes, parmi certains professionnels de santé, contribue à un diagnostic différé. Enfin, les approches subjectives dans l’évaluation de l’autisme et le manque de ressources et d’accès aux services spécialisés sont d’autres facteurs retardant le diagnostic.
Par ailleurs, la présence de tnd (troubles du neuro-développement) associés peut compliquer le diagnostic différentiel de l’autisme à l’âge adulte.
Peut-on réellement "devenir" autiste à l'âge adulte ?

L'idée de "devenir" autiste à l'âge adulte est un concept erroné. L'autisme, ou Trouble du Spectre Autistique (TSA), se manifeste généralement avant l'âge de 3 ans. Néanmoins, il existe des cas où un diagnostic n'est posé qu'à l'âge adulte. Cela est souvent dû à des symptômes légers ou atypiques qui n'ont pas été identifiés pendant l'enfance. Ce phénomène ne signifie pas que l'on développe l'autisme à un âge avancé, mais plutôt que les signes ont été mal ou non reconnus. Les adultes diagnostiqués tardivement ont souvent appris à masquer leurs symptômes dans des contextes sociaux, rendant leur identification plus complexe.
Présence des symptômes depuis l'enfance
Les signes de l'autisme sont souvent présents dès la petite enfance. Avant l'âge de 3 ans, des symptômes caractéristiques peuvent déjà être observés, bien que tous ne soient pas immédiatement apparents. Ce trouble impacte le développement notamment en matière de communication, d'interactions sociales et de comportements. Le manque de reconnaissance de ces signes durant l'enfance est souvent dû à des manifestations moins claires quand les demandes sociales sont réduites. Cependant, lorsqu'elles deviennent plus complexes, généralement à partir de l'âge d'entrée à l'école, ces différences peuvent émerger de manière plus prononcée, facilitant ainsi un éventuel diagnostic.
Réévaluation des comportements à un âge avancé
Les diagnostics tardifs d’autisme chez les adultes sont souvent le résultat d’une évaluation rigoureuse des comportements. À mesure que les critères diagnostiques évoluent, surtout avec les mises à jour telles que celles du DSM5, ils incluent de meilleurs outils pour distinguer un fonctionnement neurodivergent comme l’autisme d’autres affections. Cette réévaluation minutieuse est cruciale pour éviter des confusions avec des troubles similaires tels que le trouble schizoïde de la personnalité. Les femmes autistes sont particulièrement concernées par les diagnostics tardifs, car elles ont tendance à mieux camoufler leurs symptômes en imitant les signaux sociaux, ce qui retarde la reconnaissance des signes autistiques. Ainsi, il est essentiel de considérer les manifestations subtiles qui pourraient avoir été ignorées plus tôt dans la vie. De plus, les adultes autistes développent souvent des mécanismes de compensation pour s'adapter aux exigences sociales.
Importance d'un diagnostic tardif
En France, le diagnostic tardif de l’autisme est un phénomène courant en raison de divers facteurs. Les symptômes de l’autisme, souvent présents dès l’enfance, peuvent être subtils ou se manifester de manière atypique, ce qui complique leur identification précoce. De plus, l’évolution des critères diagnostiques et la variabilité des symptômes contribuent également à ce délai. Les adultes peuvent vivre longtemps sans diagnostic en raison de comorbidités, ce qui nuit souvent à leur qualité de vie et à leur accès aux ressources dont ils auraient besoin. Le processus de diagnostic, surtout à l’âge adulte, doit différencier le fonctionnement neurodivergent des personnes autistes de celui d’autres troubles mentaux. Chez les femmes, le masquage des symptômes pour s’adapter aux attentes sociales peut également retarder le diagnostic, soulignant l’importance d’une approche compréhensive et personnalisée.
Un diagnostic tardif peut avoir un impact significatif sur la santé mentale des personnes concernées, en aggravant notamment l’anxiété, la dépression et d’autres troubles psychologiques.
Avantages pour la compréhension personnelle
Recevoir un diagnostic d'autisme à l'âge adulte peut transformer la compréhension personnelle et relationnelle. En identifiant un trouble du spectre autistique, les individus apprennent à redéfinir les attentes et à adapter leurs stratégies de communication dans les relations interpersonnelles. Cette reconnaissance favorise une acceptation accrue des caractéristiques autistiques, conduisant souvent à un ajustement émotionnel positif. Ainsi, la découverte de l'autisme peut non seulement améliorer la compatibilité perçue au sein des relations, mais également réduire les tensions. Comprendre les codes sociaux implicites grâce à un diagnostic permet aux adultes autistes d'ajuster plus efficacement leurs interactions, enrichissant ainsi leurs relations et menant à une meilleure compréhension mutuelle.
Réduction de la stigmatisation sociale

La stigmatisation sociale liée à l’autisme est un défi persistant, mais une meilleure compréhension des troubles du spectre autistique aide à la réduire. Contrairement aux idées reçues, les TSA ne s’accompagnent pas systématiquement d’un retard intellectuel, cette diversité cognitive met en lumière les capacités souvent sous-estimées des personnes autistes. De plus, les efforts pour sensibiliser le public à l’aspect continu de l’autisme, plutôt que comme une entité binaire, facilitent une compréhension plus nuancée. La prise de conscience que l’autisme n’est pas dû à une cause spécifique identifiable par un examen médical démystifie la condition, diminuant ainsi les préjugés. Les stratégies d’adaptation déployées par les adultes autistes contribuent également à minimiser la stigmatisation, car elles permettent une intégration sociale accrue. Cette intégration et cette résilience représentent une véritable revanche sur la stigmatisation, illustrant la capacité à surmonter les obstacles sociaux.
Accès à l'accompagnement et aux ressources
L’accès aux ressources et à l’accompagnement est crucial pour les personnes autistes, notamment en France où l’autisme touche environ un million de personnes. Malheureusement, 90 % des adultes autistes ne reçoivent aucun diagnostic formel, ce qui souligne la nécessité de renforcer le processus de diagnostic et d’élargir l’accès aux services spécialisés. Les associations comme Autisme France et PAARI jouent un rôle vital en promouvant l’inclusion et en offrant un soutien essentiel aux personnes autistes et à leurs familles. Le groupement national des centres de ressources Autisme fournit des orientations vitales pour l’éducation et les soins. Les récentes recommandations de la Haute Autorité de Santé sur le parcours de vie des adultes autistes rappellent l’importance d’une coordination efficace des interventions éducatives et thérapeutiques pour améliorer la qualité de vie des autistes.
Selon la psychologue analyste du comportement Anca Ichim, il est essentiel d’adapter la prise en charge des adultes autistes en tenant compte de leurs besoins spécifiques et de favoriser un accompagnement individualisé.
Perspectives de la recherche sur l'autisme
La recherche sur l'autisme a connu des progrès significatifs ces dernières années, en partie grâce à des initiatives telles que le projet AIMS-2-Trials, qui unit 48 partenaires académiques dans le but de mieux comprendre et traiter l'autisme. Bien que l'autisme ait été reconnu comme un handicap en France depuis 1996, les adultes autistes restent souvent sous-représentés dans la recherche, leurs symptômes variant souvent de ceux des enfants. Par ailleurs, certaines études explorent des traitements expérimentaux, comme l'utilisation du lithium dans le cadre du syndrome de Phelan McDermid, lié à des mutations dans le gène SHANK3. Pour de nombreuses personnes autistes, leur condition n'est pas perçue comme une maladie, mais plutôt comme une manière unique de percevoir le monde, soulignant ainsi la richesse de la diversité neurodéveloppementale.
Rôles des bases génétiques
Les recherches en génétique ont révélé qu'environ 10% des cas d'autisme peuvent être attribués à des causes génétiques spécifiques, telles que le syndrome de l'X-fragile. Les gènes NLGN3 et NLGN4X, situés sur le chromosome X, ont également été identifiés comme liés à l'autisme. De plus, le gène CHD8 est associé à un risque élevé et joue un rôle crucial dans la différenciation des oligodendrocytes, des cellules importantes pour le bon fonctionnement du système nerveux. Il est largement reconnu que l'autisme a une origine multifactorielle, avec une forte prédisposition génétique. Les mutations dans plusieurs centaines de gènes semblent augmenter la susceptibilité à l'autisme, en particulier au niveau de la formation initiale du système nerveux.
Contributions de l'Institut Pasteur et d'InovAND
L'Institut Pasteur contribue de manière significative à la recherche sur l'autisme, fournissant du soutien à des organismes comme Autisme Info Service pour améliorer la qualité de vie des personnes autistes et leur inclusion sociale. Engagé dans un éventail de programmes internationaux, l'Institut Pasteur offre des bourses et des opportunités de coopération scientifique à travers le monde. Il travaille aussi en partenariat avec des centres nationaux de référence pour des missions sanitaires spécifiques et des partenariats industriels. L'Institut Pasteur, porteur du label Carnot, s'implique dans l'innovation et la recherche, tout en luttant contre les fake news. Tandis qu'il est largement reconnu pour son action dans le domaine de la santé publique, il joue un rôle essentiel dans des domaines variés allant des maladies infectieuses comme la Covid-19 à des initiatives centrées sur les troubles neurodéveloppementaux comme l'autisme.
Avancées potentielles pour le diagnostic et le traitement
Le diagnostic de l'autisme repose sur une évaluation clinique minutieuse, prenant en compte le développement individuel de la personne et son environnement. Les progrès récents incluent la formation continue des professionnels de santé et des intervenants psycho-éducatifs, l'amélioration des manuels diagnostiques et des tests de dépistage. Depuis 1996, l'autisme est reconnu comme handicap en France, ce qui a conduit à une sensibilisation accrue et à des ressources améliorées pour le diagnostic et le soutien. Si l'autisme ne peut pas être guéri, un diagnostic précoce et une prise en charge appropriée peuvent considérablement aider à réduire ses impacts sur la vie quotidienne des personnes concernées. Ainsi, un projet d'accompagnement personnalisé peut favoriser une meilleure insertion sociale et répondre aux besoins spécifiques des personnes autistes.
En résumé
La qualité de vie des adultes autistes peut être significativement améliorée grâce à des approches thérapeutiques adaptées. La zoothérapie et la psychothérapie cognitivo-comportementale intégrative sont des options prometteuses qui apportent des bienfaits au bien-être général. L'accompagnement personnalisé, bien que moins structuré qu'à l'enfance, joue un rôle crucial pour promouvoir l'autonomie et l'intégration sociale.
Depuis 1996, l'autisme est reconnu comme un handicap en France, soulignant l'importance d'un soutien adapté. Un diagnostic et une prise en charge précoces maximisent l'insertion sociale, y compris pour ceux diagnostiqués tardivement.
Pour optimiser l'autonomie et la qualité de vie, il est essentiel de mieux comprendre les symptômes des troubles du spectre de l'autisme et de personnaliser les approches thérapeutiques. En investissant dans un soutien individuel et des thérapies appropriées, nous pouvons améliorer de manière significative la qualité de vie des adultes autistes.
Questions fréquemment posées
Peut-on devenir autiste à l’âge adulte ?
Non, l’autisme est un trouble neuro-développemental présent dès la naissance. Cependant, il est possible d’être diagnostiqué à l’âge adulte, notamment lorsque les symptômes sont subtils ou n’ont pas été reconnus plus tôt.
Quels sont les signes de l’autisme chez l’adulte ?
Chez l’adulte, l’autisme se manifeste souvent par des difficultés dans les interactions sociales, la communication, une sensibilité sensorielle particulière, des intérêts restreints et des comportements répétitifs. Ces signes peuvent être plus discrets que chez l’enfant.
Comment se déroule le diagnostic de l’autisme à l’âge adulte ?
Le diagnostic repose sur une évaluation clinique approfondie, incluant l’historique développemental, des observations comportementales et parfois des tests standardisés. Il est réalisé par une équipe pluridisciplinaire spécialisée.
Quels sont les bénéfices d’un diagnostic tardif ?
Un diagnostic à l’âge adulte permet une meilleure compréhension de soi, une réduction de la stigmatisation, et l’accès à des ressources et interventions adaptées pour améliorer la qualité de vie.
Existe-t-il des traitements pour l’autisme chez l’adulte ?
L’autisme ne se guérit pas, mais des prises en charge adaptées, comme les interventions cognitivo-comportementales, la psychothérapie ou la zoothérapie, peuvent aider à gérer les symptômes et favoriser l’autonomie.
Contenu original de l'équipe de rédaction d'Upbility. La reproduction de cet article, en tout ou en partie, sans mention de l'éditeur est interdite.
Références
-
Anca Ichim, psychologue analyste du comportement B.C.B.A, VAINCRE L’AUTISME.
-
Haute Autorité de Santé (HAS), recommandations sur le parcours de vie des adultes autistes, 2023.
-
Autisme France, données épidémiologiques et ressources pour l’accompagnement des personnes autistes en France.
-
Centre de ressources Autisme, Groupe national des centres de ressources autisme (GNCRA), France.
-
DSM-5, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 5e édition, American Psychiatric Association, 2022.
-
Institut Pasteur, programmes de recherche et soutien aux personnes autistes.
-
Projet AIMS-2-Trials, consortium européen pour la recherche sur l’autisme.